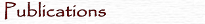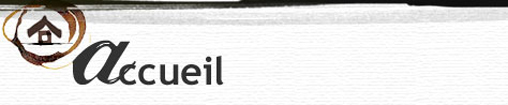Éliane MICHALON
Honorine Malland, déportée en Nouvelle Calédonie
1er Mai 1872 : Nous arrivons à Rochefort. Depuis Saint-Martin-de-Ré un léger crachin nous a accompagnées et a mouillé nos vêtements. J’ai froid. On nous fait monter sur le bateau. Une voix dure crie « Dépêchez-vous, dépêchez-vous » !
4 Mai 1872 : Première promenade sur le pont. Le soleil me réchauffe les os. Je respire fort. Trois jours sans voir le ciel. La lumière m’éblouit. La mer est calme, juste des petites vagues aux crêtes blanches, une légère ondulation, des mouettes passent en criant, je connais ces volatiles j’en ai vu parfois sur la Seine. Deux oiseaux immenses volent au-dessus du navire, une prisonnière dit que ce sont des albatros. Je revis, je lève mon visage vers le ciel pour sentir le soleil lécher mes joues, quel plaisir ! Des officiers, des femmes de fonctionnaires nous observent, ils se repaissent de ce spectacle, de notre défaite. Malgré le beau temps une odeur d’humidité imprègne mes vêtements.
6 Mai 1872 : Pas d’extérieur aujourd’hui nous sommes punies. Nous restons enfermées. Bouger me rend malade dans cette pièce sombre et encombrée. Je reste dans mon hamac qui par chance est près d’un hublot, je peux humer les embruns, essayer d’oublier les odeurs de transpiration, les relents de cuisine. J’avais gardé trois brins de menthe dans une poche de ma robe je les passe sous mes narines. Toute cette promiscuité ! Marie me berce avec ses chants bretons, sa voix est chaude et douce. Peut-être arriverai-je à dormir ?
7 Mai 1872 : Punition levée. A l’heure de la promenade je me précipite pour arriver dans les premières afin de pouvoir m’accouder au bastingage. A l’air libre il me semble que le vaisseau tangue moins. Comment font-ils ces marins pour grimper dans les cordages, grimper aux mâts, moi j’ai déjà du mal à marcher sur ce plancher savonneux. La vigie crie « Dauphins à tribord » un banc de poissons se rapproche, ils nous suivent en bondissant hors de l’eau, ils claquent joyeusement leur queue sur l’onde, ils nous accompagnent, je regarde leurs ventres blancs s’enfoncer dans les vagues vertes et ressortir un peu plus loin. Le spectacle dure plus d’une heure, puis les cétacés s’éloignent de nous. Louise dessine.
8 Mai 1872 : Je ne vis que pour cette bouffée d’air à l’extérieur, sans ce moment je crois que je me laisserais mourir. Pourtant cette immensité verte m’angoisse, quand reverrai-je la terre ? Aujourd’hui la mer est calme, transparente, infinie, pas de mouvement, le bateau semble immobile, le bois de la coque craque. Une brise légère serait la bienvenue. Le ciel est d’un bleu désespérant sans nuage .Deux hommes chantent une chanson de marins en enroulant des cordages. Les autres passagers se sont lassés de nous regarder comme des bêtes curieuses, ils nous évitent et nous ignorent.
9 Mai 1872 : Toujours cette absence de vent et cette mer létale. Nous n’avançons pas. La tension est palpable chez les membres de l’équipage comme chez les déportées. Le temps de sortie est réduit, il nous faut redescendre dans notre carré. Quelques livres circulent que nous lisons chacune à notre tour. J’ai terminé le mien. Allongée dans mon hamac gris j’écoute Noémie nous parler de l’anarchie. Mon couchage se balance doucement.
10 Mai 1872 : Enfin le vent s’est levé dans la nuit. Nous avons ouvert tous les hublots pour permettre à l’air de circuler et essayer de chasser ces odeurs répugnantes. L’humidité gluante colle à nos habits. Nous ne sommes autorisées à monter sur le pont qu’en fin d’après-midi. La journée se traîne. Louise est souffrante, je suis inquiète. Courte promenade à l’air libre. Tout a changé de couleurs, au nord de gros nuages viennent vers nous sur une mer sombre. Les matelots parlent d’un gros grain.
11 Mai 1872 : Première tempête, je n’ai jamais connu rien de tel. Nos couchettes voltigent. Les camarades hurlent dans l’obscurité. Tous les objets sont ballotés de bâbord à tribord et inversement dans un grand bruit. Les tinettes se renversent. Louise est allongée sur le sol, avec Nathalie nous la soutenons de notre mieux, nous nous serrons les unes contre les autres. Par moments nous parviennent des voix, ordres transmis à l’équipage, brutalité et peur. Nous percevons les pas précipités des hommes, le frottement des cordages au-dessus de nos têtes. Nous chantons pour avoir moins peur.
12 Mai 1872 : Je suis malade comme d’autres transportées. La tempête s’est calmée, mais un vent violent souffle encore agitant la frégate. A l’étage au-dessus on s’active sans doute pour réparer les dégâts. Je passe la journée couchée sur le plancher. Ma couverture est souillée. Je somnole. Noémie m’a donné un biscuit qu’elle a dû voler je ne sais où. Malgré les hublots ouverts on respire mal.
13 Mai 1872 : Nous voguons vers l’Afrique, le mauvais temps a disparu mais la chaleur augmente, et bientôt sera un nouveau tourment pour nous. Je vais mieux, le bateau tangue moins. L’eau est transparente, une tortue, très grosse nage un moment près de la frégate, rien à voir avec celles de nos campagnes. Le ciel est sans nuage, oppressant, il fait chaud sur le pont, alors dans cette pièce qui nous sert de dortoir nous étouffons.
14 Mai 1872 : Il fait beau. .Des signes annoncent la terre pour bientôt, les matelots astiquent gaiement le plancher en sifflotant, les mouettes de plus en plus nombreuses tournoient au-dessus du vaisseau en ricanant. Nous nous sentons plus légères, l’espoir renaît. .Je sais que c’est la première partie du voyage. Mais rien que l’idée de revoir la terre me met en joie. Des passagers se préparent à nous quitter.
15 Mai 1872 : Tôt ce matin un fracas de chaînes nous a réveillées .Je me précipite vers la lucarne. La terre, j’aperçois la terre ! Nous sommes à Dakar. .Une ville blanche se détache au-dessus des flots. Déjà je distingue des êtres qui s’affairent sur les quais, des chaloupes sont mises à la mer. Un lieutenant descend jusqu’à nous, il nous informe que le bâtiment va rester dix jours au mouillage à Dakar mais interdiction aux déportées de descendre à terre .J’avais oublié que j’étais prisonnière. Je suis anéantie, plus rien ne m’intéresse. Je ferme mon hublot.