« Lire, cela veut dire au départ « recueillir ». Le lecteur est celui qui, chemin faisant, cueille, choisit ; parfois même il dérobe en passant. Toujours la même racine : choisir, dérober. »
Olivier Chaudenson in “ Les Correspondances Manosque La Poste ” 2009
Cette page est ouverte à qui désire partager un bonheur de lecture.
Notre e.mail : ecriturearabesque@free.fr
N’hésitez pas à faire défiler la page !
________________________________________
Christian Comard
LE DOSSIER M Livre 1 de Grégoire Bouillier, aux Éditions Flammarion, 2017
Je viens de terminer la lecture du tome 1 du Dossier M de Grégoire Bouillier paru chez Flammarion. Ce pouvait être mastoc, indigeste, (l’objet papier pèse son poids, 880 pages), au contraire, c’est drôle, goûteux, léger, tout en mouvement.
Une trame d’histoire assez banale — si tant est qu’un suicide puisse être banal — : à partir du suicide de Julien, le narrateur, amant passager de la femme de cet homme, se sent en partie coupable de cette mort. Il choisit alors de tout raconter, notamment sa rencontre avec M , femme dont il a été éperdument amoureux.
Un livre au suspens étrange à mesure que le narrateur explore tel ou tel pan de cette vaste fresque. Il creuse, sinue, étire chaque moment, chaque détail. Il prend le lecteur à témoin, agrège autour du récit principal des réflexions littéraires, philosophiques, musicales.
C’est l’histoire d’un homme qui écrit son histoire, qui l’invente, qui cherche des signes dans ce qu’il écrit. C’est magnifique, des trésors d’inventions littéraires, stylistiques, typographiques. C’est jubilatoire ! D’un vin on dirait qu’il a du corps, qu’on peut le garder longtemps en bouche pour qu’il distille toutes ses subtilités. Alors, laissons-nous captiver, enivrer par ce Dossier M, ( dossier parce que, construit chapitre après chapitre, niveau après niveau, même un renvoi à un site internet, ).
Je cours acheter le second tome ( 880 pages également).
______________________________________
Geneviève Matray Morel
SOUVENIRS DE LA MARÉE BASSE de Chantal Thomas, aux Éditions du Seuil, 2017
La figure de Jackie, mère de l’auteur, est au cœur de ce roman familial. Chaque jour, comme un rite, elle pratiquait le crawl avec obstination. C’était pour elle une manière de survivre et un espace de liberté. Une passion qui l’avait conduite, adolescente à s’immerger dans l’eau du Grand Canal du château de Versailles, à l’insu des gardiens et, plus tard, enceinte de sa fille Chantal, à se baigner tout l’été dans les eaux bleues d’un lac de montagne.
La plage et les bains unissaient la mère et la fille. Pour Chantal Thomas, Jackie était cependant une énigme.
« Nager, nager, pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits. Nager pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie. »
Pour l’enfant qu’était Chantal, dans les années 50, le sable d’Arcachon et l’océan furent de formidables terrains de jeux, d’expériences multiples, grâce aux longues journées passées à jouir de l’immensité de la plage et de ses trésors. L’école d’un savoir non-académique, du plaisir, de la contemplation. Après les plages d’Arcachon, celles de Menton et de Nice. Et toujours la mer et le bonheur de nager.
Sans doute Jackie a-t-elle légué à sa fille « quelque chose d’indomptable, ou de discrètement insoumis, et cette intuition que la nage, cette pratique qui ne laisse aucune place est l’occasion d’une insaisissable liberté » (quatrième de couverture).
Sur fond autobiographique, ce livre brosse aussi le portrait d’une époque.
J’ai aimé le style de Chantal Thomas, en finesse et en élégance. De courts chapitres, une multitude de petites scènes. Beaucoup de sensations, de plaisir, de liberté. Et de ci, de là, une pointe de mélancolie ou de gravité.
Se laisser porter par la grâce de l’écriture et s‘immerger sans retenue dans ce roman, un vrai bonheur de lecture !
____________________________________________________________
Colette Danton
LA SUCCESSION de Jean-Paul Dubois, aux Éditions de l’Olivier en 2016
Dans la famille Katrakilis :
Le grand-père : Spyridon Katrakilis prétend avoir été le médecin de Staline et « posséder une fine lamelle de son cerveau dérobée lors de l’autopsie qu’il a lui-même pratiquée », conservée dans un bocal de formol qui trône dans sa chambre. En 1974, il se suicide sans raison apparents, sans explication.
Le père : Adrian Katrakilis, « homme assez inquiétant », médecin. Sa mission : « faire le mal à bas bruit », « sans un mot pour son enfant », « il avait cette appétence à palper l’âme humaine et à la tripoter comme on joue avec de la pâte à modeler ».
La mère : Anna Galien : « totalement illisible » et son jeune frère Jules avec qui elle travaille et vit comme en couple. Jules met fin à ses jours au printemps 1981, sans explication. Anne met fin à ses jours à l’été 1981. Sans explication.
Le fils : Paul Katrakilis (le narrateur). Docteur en médecine n’ayant jamais exercé, passionné depuis son plus jeune âge de pelote basque. A compris très vite que sa mère ne l’aimait pas. « D’aussi loin que remonte ma mémoire d’enfant j’ai la sensation qu’elle s’arrangeait toujours pour esquiver mes manifestations d’affection… La serrer dans mes bras était une gageure, l’embrasser un espoir sans cesse remis… » Paul fuit à 28 ans cette étrange famille ce « barnum pathogène » qui l’a « fabriqué, détraqué ». Il vit en Floride durant quatre ans, quatre années de bonheur. Il exerce la Pelotari ce qui lui rapporte de modestes revenus. Il est enfin profondément heureux. Son bateau, ses vieilles voitures, ses amours, son amitié avec Joyepi Fanio dit « le nervosio », son partenaire de quiniela passant son temps libre à QuimBar y Singar (en cubain cela signifie pratiquer l’acte sexuel). Une vie fluide et paisible. Lors d’une balade en bateau, il sauve un chien de la noyade, le baptise Watson. Ce dernier devient son confident. Ce même jour une lettre de son père l’attend ou plutôt deux photos énigmatiques… Peu après, un appel du consulat lui annonçant le décès de son père par suicide. Réaction de Paul : « il était revenu m’emmerder jusqu’ici… j’aurais dû m’agripper aux parois de son urètre, tenir bon, résister, ne jamais sortir de ce misérable conduit et le laisser se débattre dans son éjaculation stérile de médecin conventionné ».
Retour en France pour les funérailles et le règlement de la succession. Lors de l’enterrement, Paul est stupéfait d’apprendre que son père était un homme remarquable « qui aimait les autres plus que sa propre chair » alors que pour lui cet homme remarquable est resté onze ans sans parler à sa femme puis reprendre la conversation sans aucune explication ou a pu quelques heures après le suicide de sa femme se préparer tranquillement des pommes de terre sautées avec du foie de veau.
Comme lui a dit son père « un jour tu finiras par prendre ma succession », Paul rouvre son cabinet pendant dix ans… Il fait une curieuse découverte, deux carnets noirs, une autre facette d’Adrian mais jusqu’où ce fils va-t-il prendre la succession ? Que signifie la photo énigme ? Cela fait froid dans le dos. Son oncle Jules lui avait dit : « il ne faut pas se tromper de vie, il n’existe pas de marche arrière ».
Ce récit drôle, déjanté, devient au fil de l’histoire plus grave, plus amer, plus profond. Adrian et Paul se complexifient. Des questions se posent, entre autres : le suicide est-il héréditaire ? J’ai beaucoup aimé ce livre, l’originalité, le style vivant, l’écriture fluide, des descriptions qui vous embarquent, tantôt dans cette famille étrange, tantôt en Floride. Vous vivez en direct les tournois de cesta punta où la foule rugit, les descriptions des plats de poulet grillé, des haricots noirs, l’empreinte de l’air sur la langue, dans le nez…
________________________________________
Geneviève MATRAY MOREL a lu récemment plusieurs romans ayant pour thème l’Algérie. Elle nous livre ci-dessous ses lectures.
L’ART DE PERDRE, de Alice ZENITER aux éditions Flammarion, 2017. Prix Goncourt des Lycéens 2017, Prix du journal « Monde » 2017, Prix les libraires de Nancy et des journalistes du Point.
Prix Renaudot des Lycéens en 2015 pour « Juste avant l’oubli ».
« L’art de perdre » est le cinquième roman d’Alice Zeniter. d’inspiration autobiographique, ce livre puissant et sensible, écrit par une petite-fille de harkis, ravive la mémoire d’une famille kabyle ballotée entre l’Algérie et la France de 1930 à nos jours.
Il est construit en trois parties.
La première retrace le parcours du grand-père de la narratrice, Ali. Petit propriétaire terrien, notable local, harki malgré lui et contraint de fuir son pays pour sauver sa peau et celle de sa famille. Parqué dans des camps de transit il se retrouve plus tard dans une cité HLM de Normandie. Là, grandit son fils, Hamid que l’on suit dans la seconde partie du roman ; élève modèle, désireux de se faire une place dans la société française, il prend des distances avec ses parents en dépit de sa honte et de leur chagrin.
La troisième partie du livre est consacrée à sa fille Naïma. Quel lien peut-elle avoir avec l’Algérie ? Elle ignore tout de l’enfance de son père débarqué en 1962 à Marseille. Son grand-père est mort sans qu’elle ne sache comment l’Histoire a fait de lui un harki.
« Le couplet familial pour ne pas retourner ou aller en Algérie : un grand-père harki, un départ brutal, un père élevé dans la peur de l’Algérie. »
Jeune galeriste, Naïma part en Algérie récupérer les destins d’un artiste et sans vraiment se l’avouer, enquêter sur ce passé que son grand-père et son père ont préféré oublier. Au fil de rencontres, elle tente de réunir les morceaux de puzzle de l’histoire familiale et construit son « Algérie intérieure ».« Il faut tolérer de perdre sans oublier » d’où le titre du roman inspiré d’un poème d’Elisabeth Bishop, poète américaine, « Dans l’art de perdre, il n’est pas dur de passer maître… ».
512 magnifiques pages où il est question de la guerre d’Algérie, de la tragédie des harkis, de l’immigration mais aussi de quête d’identité et de liberté. »
Emue, je referme ce beau roman. Surgit alors le souvenir précis de ce dimanche de septembre 2017, aux Correspondances de Manosque. C’est l’interview d’Alice Zeniter pour ce roman. Aux premiers rangs, les harkis et leurs familles. Beaucoup de messieurs âgés, en costume-cravate impeccable. Dignes, attentifs. Fiers, reconnaissants qu’un jeune auteur évoque leur histoire dans son roman, leur rende hommage, j’ose le croire ?
EXTRAITS :
p.157 : Ils font monter à bord des animaux français, des ânes, des chevaux… Ils prennent à bord des meubles français, des plantes en pot…, des buffets larges, des automobiles… Ils font monter les statues… Mais à des milliers d’hommes à la peau sombre, ce n’est pas possible.
p.496 : Tu peux venir d’un pays sans lui appartenir, suppose Ifren. Il y a des choses qui se perdent. On peut perdre un pays.
NOS RICHESSES de Kaouther ADIMI aux Éditions du Seuil, août 2017
Kaouther Adimi est née en 1986 à Alger et vit à Paris. « Nos richesses » est son troisième roman après « L’envers des autres » en 2011, Prix de la vocation 2011 et « Des pierres dans ma poche » en 2016.
Edmond Charlot, le héros de ce roman a réellement existé.
1936 : de retour en Algérie après un séjour à Paris, Edmond Charlot, 21 ans, admiratif d’Adrienne Monnier et de sa librairie parisienne sise au 7 bis rue de l’Odéon, ouvre à Alger un lieu d’échange et d’amitié « Les vraies richesses », sous l’égide de Giono, dans un espace minuscule, à la fois librairie, bibliothèque, maison d’édition.
Il publie le premier texte de Camus « Révolte dans les Asturies » et se donne pour vocation de choisir de jeunes écrivains de la Méditerranée. S’ouvre alors pour lui toute une vie de passion, de résistance et de sacrifices face à l’infortune et aux aléas de l’Histoire.
2017 : à l’exultation d’Edmond Charlot s’oppose l’indifférence d’un jeune étudiant chargé de vider la librairie destinée à devenir une boutique de beignets.
J’ai été fascinée par l’histoire incroyable de cet homme et par le talent de ce jeune auteur qui offre, entre réalité et fiction, un éloge vibrant au passeur de mots que fut Charlot et plus largement à la littérature.
Bravo et merci à Kaouther Adimi, d’avoir exhumé cette folle histoire.
UN LOUP POUR L’HOMME de Brigitte Giraud chez Flammarion, 2017
Brigitte Giraud est née en Algérie, à Sidi-Bel-Abbès et vit aujourd’hui à Lyon.
Dans ce roman, elle interroge la guerre d’Algérie à hauteur d’homme.
Printemps 1960 : Antoine, jeune marié est appelé en Algérie juste au moment où il apprend que Lila, sa femme, est enceinte. Pour éviter d’avoir à se servir d’une arme, il demande à être infirmier et se retrouve à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès.
La rébellion gronde. L’atmosphère est électrique. Antoine s’investit avec beaucoup d’empathie auprès des blessés et mesure alors la férocité du conflit. Il se prend d’une amitié fraternelle avec Oscar, jeune caporal amputé et mutique. Rien ne le détourne du soin qu’il porte à son ami et à tous ces jeunes soldats meurtris, même pas la présence de Lila venue le rejoindre.
D’une plume sensible, Brigitte Giraud raconte le quotidien d’Antoine et de ses copains, pauvres bougres embarqués dans un conflit qu’ils n’ont pas choisi et qui les dépasse. Elle montre comment, peu à peu, l’insouciance et la légèreté de ces jeunes appelés font place à la peur et à l’angoisse permanentes.
C’est poignant et l’on comprend à quel point toute une génération a été marquée par la guerre d’Algérie.
EXTRAIT :
p.217 : Antoine n’a pas dit ce qu’il a vu, ce qu’a raconté Oscar, ce que lui ont confié les blessés. Il n’a pas écrit le plus difficile, le plus incompréhensible, le plus choquant, pour s’épargner lui-même, comme si écrire enfonçait le clou de la réalité. Il est plus facile de se taire, d’omettre et finalement d’ignorer. Surtout quand on sait que de l’autre côté personne ne veut entendre. Pourquoi écrire ce que personne ne veut lire ?… Pourquoi venir déranger le cours des choses, les pensées toutes faites que la radio relaie, le maintien de l’ordre n’est pas une guerre, les appelés ne meurent pas, l’armée française ne torture pas, les Algériens ne sont pas des sous-citoyens.
_________________________________________________
Colette DANTON
CHANSON DOUCE de Leïla SLIMANI aux éditions Gallimard, 2016
Ce livre débute par l’assassinat de deux enfants et du suicide raté de celle qui l’a provoqué : « l’autre aussi il a fallu la sauver. Elle n’a pas pu mourir… la mort elle n’a su que la donner »
Leïla Slimani décrypte cette tragédie, sans pathos, sans jugement, avec lenteur, dans un style sec comme un scalpel et en même temps analysant finement chaque protagoniste du drame.
Myriam, la mère étudiante, brillante, à la carrière toute tracée a fini ses études de droit juste avant d’accoucher de son premier enfant, Mila. Sa deuxième grossesse « a été une excuse pour ne pas quitter la douceur du foyer ». Peu à peu, hélas, cette belle mécanique s’enraye.
Myriam a la sensation que « ses deux enfants la dévorent vivante ». « L’aigreur et les regrets la rongent ». Myriam décide de reprendre sa place dans la société comme avocate. Avec son mari Paul, ils recrutent une nounou. Louise est engagée « son visage est comme une mer paisible dont personne ne pourrait soupçonner les abysses ».
En quelques semaines, la présence de Louise devient indispensable « ma nounou est une fée », dit Myriam, Paul la compare à Mary Poppins, comparaison que ne semble pas comprendre Louise.
Elle transforme l’appartement brouillon et désordonné en un intérieur bourgeois. De plus, elle prépare de succulents plats. Sa place est bien plus que simple nourrice, elle arrive de plus en plus tôt et part de plus en plus tard.
Ses patrons ne s’interrogent pas sur sa vie : où vit-elle ? Qu’a-t-elle connu avant eux? Nous ne découvrons sa vie petit à petit tout au long du récit. Lorsqu’elle quitte l’appartement de ses employeurs, elle rentre dans un studio minable et insalubre, au milieu de cartons jamais ouverts, elle ne vit qu’à travers la vie de ses employeurs à tel point qu’elle développe une véritable fixation : la venue chez eux, d’un troisième enfant qui lui permettrait de garder sa place. Sinon elle finirait clocharde, elle est d’ailleurs fascinée par « les errants les précaires ».
Louise aime beaucoup jouer avec les enfants, la description d’une partie de cache-cache donne froid dans le dos: «Eux se cachent (Mila et Adam), elle aime observer les enfants qui ne la trouvant pas pensent qu’elle les a abandonnés ». « Elle les regarde comme on étudie l’agonie du poisson à peine péché, les ouïes en sang, le corps secoué de convulsions […] le poisson qui n’a aucune chance de s’en sortir ».
Le désespoir des enfants ne la fait pas plier.
Plus tard dans le récit, la séance de la carcasse de poulet met la puce à l’oreille de la mère. Paul la rassure, alors que quelques semaines plus tôt il a eu une altercation avec Louise et face au silence glaçant de cette dernière il a voulu la congédier mais Myriam a plaidé sa cause. L’obsession de faire carrière étant plus forte que tout.
Jacques, le mari de Louise (qui à sa mort ne lui a laissé que des dettes), lui reprochait d’avoir « une âme de carpette à ramasser la merde et le vomi des mioches », mais peu à peu, la carpette qui toujours cherchait à faire le bonheur des autres en s’oubliant, devient pleine de haine. « Une haine monte en elle .Une haine qui vient contrarier ses élans serviles et son optimisme enfantin ». Angoisse de finir comme « ce clochard qui chie dans la rue sous son nez » à deux pas de son pauvre logement…
La folie meurtrière est en route et l’on comprend pourquoi l’auteur a mis en page de garde ce passage de Dostoïevski :
« Savez-vous, Monsieur ce que cela signifie quand on n’a plus où aller ? [..].Car il faut que tout homme puisse aller quelque part ».
Colette Chabanon
ACCABADORA de Michela Murgia, aux éditions du Seuil, prix pages des libraires 2011.
Filius de anima : c’est ainsi qu’on appelle les enfants doublement engendrés, de la pauvreté d’une femme et de la stérilité d’une autre.
Maria est la quatrième enfant d’Anna Theresa Listru : « Ah ! Si j’avais pu ne pas l’avoir ! Elle constituait une erreur après trois réussites »… Maria : « arrivée trop tard dans le ventre de sa mère… était le cadet des soucis dans une famille qui n’en avait que trop ».
Anna Theresa Listru aimait raconter que son époux ne s’était même pas montré utile en crevant à la guerre, ce qui lui aurait valu une pension. Sissioniu Listru était mort aussi bêtement qu’il avait vécu. Veuve, elle avait quitté la pauvreté pour la misère.
« Bonaria Urrai souriait les mains sur son ventre plat satisfaite de ce qu’Anna Theresa venait de lui offrir » : Maria âgée de six ans. « Cet avortement rétroactif ne parvint pas lui non plus à éveiller le moindre sentiment sur le visage de Maria ».
L’histoire se déroule dans un village sarde, dans les années cinquante. Peu à peu, Maria s’apprivoise et grandit avec cette vieille couturière sans âge, pleine de tendresse, peu démonstrative mais très présente. Cependant un mystère plane : pourquoi cette vieille femme s’absente-t-elle certaines nuits ?
La vie de Maria va être bouleversée par la découverte de ce secret, connu de tout le village. Rumeurs, chuchotements et médisances, la mort omniprésente, à la fois crainte et vénérée : des pleureuses officielles aux portes restées ouvertes les nuits du premier novembre pour accueillir les âmes qui se promènent…
Le style est léger, subtile, fin et drôle quelquefois, malgré les thèmes abordés : la mort et… ?
En dire plus serait dévoiler le fond de l’intrigue.
Bonne lecture !
LE KOALA TUEUR ET AUTRES HISTOIRES DU BUSH de Kenneth COOK, traduit par Mireille Vignol, aux éditions Le Livre de Poche.
L’auteur a toujours soutenu que les quinze histoires racontées dans son livre bien que réellement vécues sont tellement invraisemblables qu’il ne pouvait pas les inclure dans ses romans.
Ces quinze récits se passent dans la brousse australienne, Cook se trouve confronté tantôt avec des animaux : serpents, koala tueur, crocodile cochon ou des individus complètement déjantés !
Ses descriptions, hommes, animaux, les situations complètement folles dans lesquelles il se trouve, sont décrites avec une drôlerie et un humour extraordinaires.
Si vous avez envie de rire, allez-y :
La vie sexuelle des crocodiles
Roger Huntingdon a pour projet d’étudier les grands crocodiles. Il invite l’auteur à l’accompagner.
« Il ne tenait guère de place dans le bateau, un détail appréciable car ce n’était pas mon cas – on me qualifiait d’obèse, je me considère simplement corpulent, une centaine de kilos disons – ». Ils accostent sur une petite plage et en examinant les traces dans le sable, Roger se réjouit car il semble qu’il y a quatre femelles et à voir des traces encore plus énormes il annonce à Cook que le mâle doit être énorme… il l’est en effet !
Après l’accouplement, plus que mouvementé c’est le moins que l’on puisse dire, à la question « Je me demande où il va aller », posée par Roger « la créature émergea de l’eau à une trentaine de mètres de notre emplacement. Elle était gigantesque… elle n’en finissait pas de sortir des mètres entiers de crocodile meurtrier… » voir la suite.
Cédric le chat
« Le chameau a l’haleine la plus fétide de la création, un mélange de crottes de vautours et de furets passablement morts. Le chameau possède également l’étrange capacité de vous souffler à la figure même quand vous êtes sur son dos et… de plus, il mord ! »
Histoire du cochon furibond
« Aucun animal n’a une tête plus moche que le cochon d’Australie. Son caractère est assorti je sais de quoi je parle : une de ses bêtes a tenté de me dévorer. Elle était dans son droit puisque je venais d’essayer de lui tirer dessus. »
La suite du récit est vraiment cocasse.
Geneviève Matray
ALGÉRIE 1954-1962 de Benjamin Stora et Tramor Quémeneur aux éditions Les Arènes, 2010
Ce livre a obtenu le Grand Prix des Lectrices de Elle 2011, dans la catégorie « Document ».
Quel livre ! Un ouvrage magnifique sur l’histoire complexe et douloureuse de la guerre d’Algérie. Une démarche originale qu’explique Benjamin Stora dans la préface de l’ouvrage.
« À côté de l’imposante réserve des archives officielles d’Etat, il existe cet autre stock d’archives privées. Dans mon travail d’historien sur la guerre d’Algérie, cette notion des « autres archives » m’a toujours intéressé. Les morceaux de vie intime sont souvent plus révélateurs que les rapports officiels et austères.
Cet ouvrage cherche la restitution des sensations. Ce « matériel » précieusement retrouvé et reconstitué, donne toute la chair de cette histoire, si difficile à comprendre pour les jeunes générations. Ce livre veut donner à voir toutes les mémoires… ambivalentes, contradictoires, opposées ».
Un pari de départ ambitieux. Une réussite remarquable. Tout y est : un contenu passionnant et émouvant, une mise en pages superbe et soignée. Dans ce livre-objet, B. Stora, aidé de Tramor Quemeneur, lui aussi historien, propose une exploration impartiale du passé. Y figurent de nombreux témoignages ainsi que cent documents inédits, fac-similés, collés sur les pages, ou glissés dans des enveloppes. Fragments d’histoires administratives ou personnelles qu’on peut palper, extraire, déplier : carte routière, photos, lettres, cartes postales, carnets, extraits de journaux de l’époque. Non seulement des faits, des dates et des chiffres mais des visages. De nombreuses voix : celles des pieds-noirs, des Algériens, des appelés, des nationalistes du FLN ou du MNA, des partisans de l’Algérie française, des harkis… Des voix plus illustres comme celle du général De Gaulle (4 juin « Je vous ai compris »,1961 : dénonciation du putsch de
généraux) ou d’Albert Camus qui « désapprouve totalement le terrorisme qui touche aux populations civiles » -(25 mars 1955).Le livre suit une chronologie minutieuse, de l’Algérie « d’avant le conflit » jusqu’au « cessez-le-feu »et à l’été 62. Il évoque le déracinement des pieds-noirs, les fêtes de l’Indépendance Algérienne, l’abandon cruel des harkis. Chaque chapitre illustre une thématique bien définie que complète le regard pointu de l’historien.
C’est un document d’une richesse incroyable, accessible à tous. Il revisite l’Histoire d’une manière attrayante et pédagogique. L’Education Nationale devrait l’offrir à tous les établissements scolaires car presque cinquante ans plus tard, on parle peu de la guerre d’Algérie à l’école. La littérature et le cinéma ont mis longtemps à s’en emparer. Les mémoires sont encore à vif. Témoin, la polémique soulevée par la projection à Cannes, en mai 2010, du film « Hors-la-loi » de Rachid Bouchareb. Cet ouvrage est précieux. Il contribue au devoir de mémoire et stimule l’esprit critique.
« L’heure est maintenant venue du passage de la mémoire douloureuse à l’histoire accomplie, de la blessure à l’apaisement… Ce livre aux couleurs émouvantes des premiers appareils de photos couleurs appelle à une nécessaire réconciliation des mémoires ».
L’actualité ne peut être comprise qu’à la lumière du passé. Il est temps de se tendre un peu plus la main, de part et d’autre de la Méditerranée.
JUST KIDS de Patti Smith aux éditions Denël, 1999, traductrice, Héloïse Esquié.
Clin d’œil ! Je débute la lecture de « Just Kids » le jour même où Patti Smith investit la Cité de la Musique et la salle Pleyel dans le cadre d’une semaine « carte blanche ».
Ce n’est ni un livre sur le rock, ni une simple biographie de « l’icône américaine » du punk, mais un hommage vibrant au photographe Robert Mapplethorpe son ex- compagnon, frère et ami de toujours, mort du sida en 1989, à quarante-deux ans. Un récit initiatique de deux « enfants terribles », artistes en devenir. Un témoignage précieux sur l’époque foisonnante du « New-York Underground » de la fin des années 60 et de la décennie 70.
À vingt ans, Patti Smith rêve d’appartenir à la fraternité des artistes et débarque à New-York, sans un dollar en poche. Seule la poésie l’intéresse alors. Elle se nourrit de Rimbaud à qui elle voue une véritable passion (sans argent, elle a volé un exemplaire des Illuminations). Pour survivre, elle multiplie les petits boulots. « Personne ne m’attendait. Tout m’attendait » écrit-elle. Cela commence l’été 1967. Celui de la mort de Coltrane, de Jimi Hendrix qui mettait le feu à sa guitare, des émeutes à Newark, Milwaukee et Detroit.
L’été de l’amour. Elle croise, par hasard, Robert Mapplethorpe, « jeune berger hippie ». Rencontre fulgurante de deux gamins fauchés, pétris de rêves et d’ambition. « À son réveil, il m’a gratifiée, de son sourire en coin, et j’ai su qu’il était mon chevalier ». D’emblée, un lien profond les unit. Ils font le pacte de se vouer ensemble à l’art et de toujours prendre soin l’un de l’autre. Ils ratissent les milieux culturels de New-York, s’installent au Chelsea Hôtel, havre de nombreux artistes de la « beat génération » : musiciens, écrivains, philosophes. Ils vivent dans le dénuement, et pourtant joyeux, soudés, solidaires même s’ils n’ont ni le même univers, ni la même ambition. Duchamp et Warhol sont les deux modèles de Robert qui vise « le grand art et la haute société ». Patti, elle, vénère Rimbaud et Baudelaire, s’inscrit dans le sillage de Kerouac, Genet, Allen Ginsberg, William Burroughs, Sam Sheppard, Bob Dylan, Janis Joplin… En quête d’absolu, ils se stimulent, s’encouragent mutuellement et respectent leurs différences.
À priori, rien ne les prédispose à devenir des artistes mondialement connus. Tous deux, débarquent de leur province, elle de Chicago, où elle a passé une enfance modeste dans l’amour des livres et le désir puissant de s’exprimer, lui de Floral Park, Long Island, fasciné par la beauté depuis son plus jeune âge, très doué pour l’esquisse et se percevant déjà artiste. Artiste plasticien, Robert ignore qu’il sera homosexuel et qu’il deviendra un photographe sulfureux et adulé. Quant à Patti, elle ne songe pas à être musicienne. Elle veut seulement « insuffler dans le mot écrit l’immédiateté et l’attaque frontale du rock n roll ».
Que dire encore du mystère de la création artistique, de la fidélité aux rêves de jeunesse, de l’innocence, de la ténacité, de l’enthousiasme ?
« Just Kids » s’ouvre et se ferme sur R. Mapplethorpe. Avant la mort de celui-ci, Patti Smith lui avait promis d’écrire leur histoire commune. Belle lettre d’adieu, dans laquelle elle s’efface, met en lumière sa relation avec l’illustre photographe et célèbre l’Art.
Une écriture âpre, dense et poétique. Un livre émouvant et généreux.
LA MAISON D’À CÔTÉ de Lisa Gardner aux éditions Albin Michel, 2010
Ce livre a obtenu le Grand Prix des Lectrices de Elle 2011, dans la catégorie « Policier »
Qu’est-ce qui peut pousser une jeune enseignante au-dessus de tout soupçon, résidant dans un quartier résidentiel au sud de Boston, à s’enfuir de chez elle, après s’être occupée, comme tous les soirs, de la douche, du repas et du coucher de sa petite fille de quatre ans ? À moins qu’il ne s’agisse d’un rapt ou d’un meurtre ? Cela semble n’être qu’une banale histoire de disparition mais Lisa Gardner nous entraîne avec habileté dans un jeu savant de mensonge et de vérité.
En pleine nuit, Jason, journaliste de retour du travail, découvre que sa femme Sandra a disparu, abandonnant leur petite fille endormie. Le lendemain, le commandant D.D. Warren, inspectrice au caractère bien trempé, est appelée en urgence par un collègue et se rend sur les lieux. Dès qu’elle pénètre dans la maison, elle sent que quelque chose cloche. Pas de trace d’effraction ni de violence, seule une lampe brisée, un édredon manquant et le chat, lui aussi disparu. L’inspectrice n’écarte aucune hypothèse et tente en vain d’interroger le mari. Le comportement de Jason est étrange ce qui en fait le suspect idéal. Il n’a prévenu la police que trois heures après la disparition de sa femme, reste muet, n’a aucune réaction ni émotion et ne s’occupe que d’isoler et protéger sa fille, seul témoin potentiel. D.D. Warren et son adjoint soupçonnent des failles dans le couple Jason/Sandra. Plus le temps passe, plus la disparition de la jeune femme devient inquiétante, plus le nombre de suspects augmente : le mari mystérieux, le jeune voisin ex-délinquant sexuel, l’élève de treize ans surdoué en informatique et amoureux de sa prof, le flic informaticien, le père de la victime brouillé avec elle et qui semble avoir de bonnes raisons de réapparaître. On apprend que Jason passait des heures la nuit sur son ordinateur et qu’il est difficile de sécuriser toutes les données. Tout un pan de l’enquête tourne autour de cela. Curieux et paradoxal de constater que cette famille, qui se barricadait dans sa maison le soir, avec force serrures de sécurité aux portes et aux fenêtres, ait laissé la porte grande ouverte via internet !
Les pistes se brouillent. L’enquête piétine et le suspense monte. Le lecteur en sait plus que les enquêteurs grâce aux « voix off ». Les points de vue des uns et des autres alternent, se complètent se contredisent ce qui donne beaucoup de complexité au récit et du fil à retordre aux inspecteurs.
Aucun des suspects n’est réellement ce que les autres perçoivent ou imaginent. On le devine et c’est tout le savoir-faire de Lisa-Gardner de maintenir la tension jusqu’aux dernières pages, sans que le rythme ne faiblisse.
Dans ce livre l’auteur a choisi une forme narratrice intéressante, émaillant le récit de « voix-off » où les personnages s’expriment. Elle a su aborder avec tact le sujet délicat de la pédophilie à travers l’histoire du jeune voisin et décrire finement la psychologie et le comportement de ses personnages.
Ce roman est plus qu’un policier brillant, il nous parle du secret, du poids des drames intimes et de la difficulté d’en guérir.
Avant la lecture de « La maison d’à côté » je ne connaissais pas Lisa Gardner. Je suis ravie d’avoir découvert le talent d’une des « reines du polar ».
LA COULEUR DES SENTIMENTS de Kathryn Stockett chez Actes Sud
Ce livre a obtenu le Grand Prix des Lectrices de Elle 2011, dans la catégorie Roman
Jackson, Mississippi, 1962 John Kennedy est encore président des U.S.A. Les femmes commencent à prendre la pilule et à découvrir le Valium. Bob Dylan chante. Stevie Wonder aussi, ce jeune gamin noir.
On pleure les morts du Vietnam. La voix de Rosa Parks résonne et Martin Luther King s’apprête à marcher sur Washington.
Près d’un siècle après la Guerre de Sécession, la ségrégation raciale sévit toujours dans les États du Sud et l’ombre du Ku Klux Klan plane encore. La bonne société blanche, provinciale et traditionnaliste exploite sans vergogne les « bonnes Noires ». Ces femmes, invisibles pour leurs patrons, triment pour quelques dollars par jour, briquent les maisons de fond en comble, cuisinent, et prennent soin des enfants.
C’est dans ce contexte que se situe « La couleur des sentiments ». Un roman choral. Trois voix, trois caractères bien trempés, trois points de vue. Un trio de choc : deux domestiques Noires et une jeune bourgeoise Blanche.
Aibileen, cinquante-trois ans, a élevé dix-sept enfants, « on pourrait remplir toute la cuisine avec » dit-elle. Elle travaille chez les Leefolt, s’occupe des tâches ménagères et de la petite Mae Mobley qu’elle chérit, à l’inverse de sa mère qui lui accorde peu d’attention. Minny, trente-six ans, cinq enfants, un mari brutal, est la meilleure cuisinière de la ville. Elle ne mâche pas ses mots et ne supporte pas l’injustice, ce qui lui vaut de fréquents renvois. Miss Skeeter, vingt-deux ans, fille d’un des plus grands planteurs de la région, revient au pays après ses études. Le départ mystérieux de Constantine, sa nounou bien-aimée, l’intrigue. Elle étouffe dans son milieu, étriqué et conventionnel. Peu lui importe de trouver un bon mari, elle rêve de devenir écrivain. Sensible à l’injustice dont souffrent les Noirs, elle apprivoise Aibileen et Minny, recueille leurs témoignages pour écrire un livre. À elles trois, fortes de leur amitié et du désir de changer les choses, elles vont braver
courageusement les peurs et les interdits et mener en secret ce projet fou.
Avec ce roman d’inspiration autobiographique, l’auteur traite le sujet épineux de l’apartheid avec justesse, pudeur et humour. Il y a bien quelques clichés … mais le charme
opère. D’une plume simple et efficace, Kathryn Stockett a su rendre l’ambiance tendue de cette époque et analyser l’ambivalence des rapports entre les deux communautés : affection, mépris, préjugés, complicité etc. Ses personnages sont bien campés et attachants.
« La couleur des sentiments » ? Une jolie fable, dans la filiation de « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur », à lire installé dans un rocking-chair, avec des champs de coton en arrière-plan et du blues comme fond sonore.
Tout est en place pour le futur film de Spielberg : les images, les sons, les couleurs et en prime l’émotion, les rires et les larmes.
NOS ÉTOILES ONT FILÉ d’Anne-Marie Revol chez Stock, 2010
Ce livre a obtenu le Grand Prix des Lectrices de Elle 2011, dans la catégorie « Document »
Comme il m’est difficile de commenter ce livre poignant, empli de larmes et de rires, de souffrance et d’espoir ! Du débutà la fin, je l’ai lu, le cœur serré.
11 août 2008 … les médias se font l’écho d’une tragédie insoutenable. Deux fillettes, deux sœurs de 2 et 1 an, Pénélope et Paloma, périssent dans l’incendie de la maison de leurs grands-parents, alors que leur maman Anne-Marie Revol, journaliste, de retour de Grèce avec son mari, s’apprête à les rejoindre. Des messages téléphoniques au petit matin et la terrible nouvelle tombe. La vie bascule à tout jamais…
On dit qu’on est orphelin quand on perd l’un de ses parents ou les deux, veuve ou
veuf quand il s’agit de son époux ou de sa femme « En revanche, quand on perd ses enfants, on ne dit rien. Il n’y a pas de mot pour désigner cet état. Est-ce si épouvantable pour que cela soit innommable ? » Face à l’insupportable, Anne-Marie et Luc son époux, songent au suicide mais très vite décident de continuer à avancer, de s’épauler, forts de leur amour immense, afin que leurs « étoiles filantes » soient fières d’eux. Pour survivre et maintenir le lien avec elles, l’auteur décide de leur écrire chaque jour. Elle se confie, leur parle d’elle, de leur papa, des choses simples du quotidien. Ligne après ligne, étape après étape, on suit le processus du deuil : les premiers jours et l’enterrement vécus dans un état second, les premières semaines, les premiers mois, la première année jusqu’au triomphe de la vie avec la naissance d’un petit Lancelot. Le ton est juste .Avec naturel et simplicité A.M Revol décrit sans apitoiement ni complaisance les moments de colère, de culpabilité, de rage, les moments où son mari et elles se trouvent au creux de la vague, « vampirisés » par leur chagrin, les moments où de menus objets, des situations, des rencontres, font ressurgir des souvenirs. Elle parle aussi des rires qui reviennent, des instants de bonheur éphémères et réels, du pouvoir de s’émerveiller encore, de l’absence de rancœur envers les grands-parents. Elle dit combien le chemin du deuil est long et escarpé.
Elle fait le pari d’une vie après la vie, car pour elle il n’y a pas d’autre choix. Elle avoue que la journée est foutue si elle n’arrive pas à placer une fois par jour, à un inconnu, que ses fille ont disparu.
« J’aspire à ce que les gens qui ignoraient tout de votre existence avant de m’avoir croisée, vous confèrent une place de choix dans leur cœur »
En tête de ses lettes, l’auteur s’adresse à ses filles avec des mots inattendus
et fantaisistes : mes pépites d’amour, mes perles de pluie, mes porte-bonheur, mes fées, mes gribouillis, mes lucioles… C’est doux, tendre et beau.
Voici un texte bouleversant et loin d’être déprimant. Un hymne à la vie et à l’amour.
Une leçon de dignité et de courage.
Un bel hommage à Pénélope et Paloma qui, à en pas douter, sont vivantes dans le cœur des lecteurs grâce aux mots de leur maman.
DANS LA NUIT BRUNE de Agnès Desarthe, aux éditions de l’Olivier, 2010
Dans ce texte singulier, au charme envoûtant, Agnès Desarthe esquisse le portrait d’un homme fragile, à la recherche de ses origines. Elle signe un roman intimiste, un conte moderne où se mêlent réalité et fantastique. Elle dresse le portrait d’un anti-héros.
» Une boule de feu qui valdingue d’un côté à l’autre de la nationale… le gamin sur sa moto » . Phrase choc. Témoignage paru dans le journal. Annonce d’une mort violente. Jérôme, la cinquantaine, agent immobilier, divorcé , vit avec sa fille, Marina, dix-huit ans. Tout bascule quand il apprend la mort du petit ami de la jeune femme. Un peu « décalé », indifférent jusque-là à son passé, il est ébranlé par le chagrin de sa fille et ne sait plus ni d’où il vient , ni où il va. Cette mort injuste le jette en plein désarroi et fait surgir tout un pan de son passé : douleur enfouies, non-dits, questions tapies au fond de lui .
« Enfant trouvé » dans un bois par un couple vieillissant, il n’a jamais entrepris de démarches pour éclaircir l’énigme de sa naissance et de son adoption. Il s’interroge alors sur ses origines, sur sa peur de l’amour, sur sa solitude.
Pour se soigner, il a besoin de fuir dans la forêt . » Il voudrait… marcher dans le froid, dans la nuit humide et parfumée par les arbres qui suent, emprunter la route cabossée
qui mène à la forêt… creuser sous les feuilles, entre les racines, dans la boue, se faire un terrier… se sentir aussitôt apaisé et s’endormir là, dans les bois, dans la terre, sous les feuilles ». D’où vient « l’enfant sauvage » qu’il a été ? Il faudra à nouveau plonger dans la nuit brune pour le découvrir. Des personnages quelque peu mystérieux, vont graviter autour de lui, transformer sa vie, l’aider dans sa quête de vérité : Rosy, la jeune médium obèse, Alexandre le flic homo à la retraite, Vilno l’Écossaise fantasque et sensuelle.
Le mystère de ses origines ne sera percé qu’à la fin du livre quand le récit aura dérivé lentement vers l’histoire terrible de la déportation des Juifs.
C’est un livre subtil et profond qui aborde les grands thèmes de l’existence. Le ton est juste, l’écriture limpide et légère.
J’ai aimé ce roman, tout en nuances et en clairs-obscurs, où conte et réalité se côtoient. Empathie pour Jérôme, homme sans passé, désireux de se réconcilier avec la vie. Émue par le petit enfant qu’il a été, abandonné dans la forêt comme le Petit Poucet, puis recueilli par un couple de promeneurs.
Le livre refermé, il y a comme une musique douce et nostalgique qui continue à trotter dans la tête.
ROSA CANDIDA de Audur Ava Ólafsdóttir, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, aux éditions Zulma en 2010
Histoire singulière que ce premier roman de l’islandaise Audur Ava Olafsdottir !
Est-ce un roman d’initiation ? Une fable moderne ? Un roman de la rose ? Sans doute, un peu tout cela et surtout un texte au charme étrange. Un récit tout en douceur et poésie.
Arnljotur, vingt-deux ans, aurait pu faire de brillantes études. Après avoir été pêcheur, il projette de redonner vie à la roseraie, jadis célèbre, d’un monastère. Il partageait la passion des roses avec sa mère, récemment décédée. Mal remis de ce deuil, il quitte les champs de lave et les mousses grises de son île natale, laisse derrière lui son père octogénaire et surprotecteur, son frère jumeau autiste, sa fille Flora Sol née d’une union éphémère avec Anna. Il s’embarque, à bord d’une vieille OPEL, avec dans ses bagages quelques boutures d’une rose très rare, à huit pétales, la « rosa candida », qu’il souhaite replanter dans le jardin mythique, en mémoire de sa mère tant aimée. Débute alors une sorte de road movie. Un périple ponctué de mésaventures, de rencontres insolites, de personnes aux mœurs différentes, de paysages inconnus… qui le conduit jusqu’au « Merveilleux Jardin des Roses Célestes ».
Arrivé à destination, dans un lieu retiré où l’on parle une langue en voie d’extinction, le jeune homme se consacre à sa passion du jardinage et se lie d’amitié avec un moine, Frère Thomas.
« Je me sens bien au jardin ; c’est bon de profiter des plates-bandes pour sonder ses aspirations et ses désirs, muet en pleine terre ».
Dans cette atmosphère paisible, il se questionne« sur le corps » (le sien, celui des autres), sur la vie, sur son avenir. Rattrapé par la réalité, il est rejoint dans sa retraite par Anna, presque inconnue, et par Flora Sol, sa fille « par accident ». Il fait alors l’apprentissage de la paternité, de l’amour, de la cuisine… et se prend à rêver d’une vie de famille, tout en continuant le travail de la terre.
Ce roman nous plonge dans un espace indéterminé, hors du temps, en pleine nature, loin de l’agitation du monde. On y côtoie des personnages hors du commun : un Candide des Temps Modernes, une jeune femme mystérieuse et fantasque, une fillette précoce à l’aura quasi mystique, un moine cinéphile et conseiller conjugal à ses heures. Cette sorte d’hymne à la nature, désuet, truffé de références culinaires et botaniques, aurait pu sombrer dans une banalité et une mièvrerie affligeantes, sans le talent de conteuse de l’auteur.
La mort, le désir, l’amour et les roses se fondent en une alchimie subtile. C’est drôle et plein de fraicheur. D’où l’intérêt de ce livre, véritable ovni dans le paysage littéraire. À savourer comme un petit plaisir simple et revigorant avec en prime le parfum délicat de la « rosa candida ».
Colette Danton
RIEN NE S’OPPOSE À LA NUIT de Delphine de Vigan chez J C Lattès
Prix du Roman Fnac 2011
L’auteur découvre sa mère, Lucile, morte dans son petit appartement. Son suicide remonte à plusieurs jours.
Cette mort lui laisse beaucoup de questionnement. Aussi décide-t-elle d’écrire « sur sa mère autour d’elle ou à partir d’elle ».
C’est une véritable enquête, elle interroge frères et sœurs, amies, écoute des enregistrements de son grand-père (le père de Lucile).
Et on découvre cette adolescente puis cette femme qui décide de sa mort car elle veut mourir vivante « avant d’être une vieille dame ».
D’un ton d’abord léger, badin, déjanté, peu à peu on pénètre au cœur de cette famille.
Le récit est passionnant. J’ai littéralement dévoré ce bouquin.
Marie-Agnès Chavent-Morel
UN HOMME LOUCHE
de François Beaune aux Editions Verticales, septembre 2009.
Un livre tout en focalisation interne. Une posture d’auteur que j’apprécie particulièrement pour la finesse de regard, d’écoute, d’approche qu’elle requiert, de grande sensibilité. Avec des pensées qui rejoignent l’universel, obligent à lever le nez du bouquin, à penser, à s’interroger ou à laisser tomber ! Même si au début j’ai trouvé facile (quelle prétention de ma part !) et parfois agaçante l’écriture où je sentais l’auteur, jour après jour, laisser aller la plume au gré de ses captations et sensibilités du moment.
Un livre émouvant et « terriblement » 21ème siècle.
EXTRAITS
« En même temps qu’il est, il réfléchit à ce qu’il devrait être et ça l’emmêle. »
« Il n’y a pas que des hommes sur cette terre, il y a aussi des voisins, des arbres, des familles, des sociétés, des ennemis. »
« Je suis comme une cocotte-minute. L’alcool augmente ma pression interne. Je m’approche du bord de l’explosion. Et quand j’explose, j’oublie tout. Je cherche à cogner dans les murs, à me flanquer la tête dans les angles des tables en verre. Je lâche toute l’agressivité. Le matin j’ai hinte et je prends de sages décisions qui s’accumulent dans la cocotte. Et le cycle reprend. Quand j’atteins la température, j’augmente de quelques degrés avec l’alcool. Je suis un autre dans ces moments-là. Je suis toute ma terreur d’être sur terre. »
Jacqueline Moulin
LES BRAISES de Sándor Márai
Un général retiré du monde reçoit la visite de son ami d’enfance. Cette visite, il l’attend depuis 41 ans.
Les thèmes centraux sont l’amitié, la vieillesse et le besoin de savoir pourquoi à un moment de sa vie, un ami vous a trahi.
A travers la dramatique confrontation des deux vieillards, Les Braises évoque l’inéluctable avancée du temps. L’écriture est fluide, les descriptions sont soignées. Plus l’entrevue avance, plus on a l’impression d’assister à une partie d’échecs (atmosphère tendue, réserve, attaques, suppositions et non-dits) à la différence que l’un des deux mène le jeu.
EXTRAIT
« Cette journée avait scindé ma vie en deux… »
« Notre amitié était pareille à celle des vieilles légendes. Mais tandis que j’évoluais dans les régions ensoleillées de la vie, toi, tu restais volontairement dans l’ombre… »
« Ma nature et mon éducation n’admettaient pas d’autre solution. Elles ont déterminé mon attitude. Tu trouves que ma façon d’agir était inhumaine ? »
Dans la vieillesse, la mémoire agrandit chaque détail et nous donne une image claire et parfaite du passé .
Sándor Márai est reconnu comme l’un des plus grands auteurs de la littérature hongroise. À découvrir absolument.
TROIS FEMMES PUISSANTES
de Marie Ndiaye
Trois récits, trois femmes qui disent non.
Elles se battent pour préserver leur dignité, c’est une exploration minutieuse des tourments intimes.
Malgré les difficultés, chacune a une force intérieure inaltérable qui en fait des femmes puissantes, même si d’un point de vue social ou professionnel elles n’ont aucun pouvoir.
Ce roman, dans une prose raffinée, nous plonge dans la réalité des conditions de migration d’hommes et de femmes prêts à tout pour une vie meilleure.
À lire, même si quelquefois il faut s’interrompre pour respirer…
LA PETITE CHARTREUSE » de Pierre Péju
J’ai relu ce roman qui m’avait bouleversée lors de sa sortie.
Eva, privée d’enfance, cloîtrée dans son silence sans avoir fait le voeu, Vollard géant solitaire, qui ne vit que pour ses livres, leur rencontre est « brutale ».
Face à la mère d’Eva, qui fuit ses responsabilités, le libraire utilise ses livres pour essayer de réveiller Eva. Petit à petit, l’écorce du volumineux libraire s’effrite mais la petite fille reste muette…
EXTRAIT
« J’ai vu qu’elle n’osait pas trop parler à la gosse. C’est dommage. Il le faut pourtant. Vous verrez un jour il y aura un déclic. On ne sait jamais quel mot, quelle parole parvient à les réveiller. Une seule phrase peut tout déclencher. C’est un bout de fil qu’il faut alors tirer et tout le reste revient. »
À lire ou à relire.
Stephan THIERS
AUTOPORTRAIT DE L’AUTEUR EN COUREUR DE FOND de Haruki Murakami
Ce journal, cet essai est une quête de vérité, Murakami court vers la lumière et nous emmène vers le talent qui est en chacun de nous.
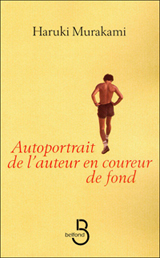
Je suis en retard sur Haruki Murakami.
Cet écrivain japonais a commencé à courir à l’âge de trente trois ans.
Il a écrit son premier roman juste avant ses trente ans.
Courir devient une métaphore de son travail d’écrivain.
J’ai commencé à écrire il y a quatre ans et demi afin d’explorer ma nature.
J’ai commencé à courir voici deux ans afin d’explorer encore ma nature.
Aujourd’hui, je croise Haruki Murakami dans un « Autoportrait de l’ auteur en coureur de fond ».
Par avance, je me dis que je suis dans les temps de passage, que demain est encore loin, qu’écrire est un chemin, que courir sur ce chemin me fera rencontrer mon premier roman, et que « Comme la vie, la course ne tire pas son sens de la fin inéluctable qui lui est fixée… »
Geneviève MATRAY :
LES DEFERLANTES de Claudie Gallay.
La Hague… À la pointe du Cotentin. Un coin du bout du monde battu par les flots. Un vent tellement violent, dit-on, qu’il arrache les ailes des papillons. Une terre âpre, où la narratrice, employée dans un centre ornithologique, vient panser ses blessures.
Gravitant autour d’elle, entre le café, le phare et le port, des personnages étranges, rugueux, des « taiseux ».
La mer et ses tempêtes d’équinoxe, omniprésente, qui prend les hommes et ne les rend pas toujours, empêche les familles de faire leur deuil, les font espérer un impossible retour.
Et puis, l’arrivée de Lambert sur les traces de son enfance mutilée. Ses errances magnifiques.
Enfin, beaucoup de « non-dits » autour d’un drame ancien que la narratrice finira par lever.
J’ai aimé : l’atmosphère de ce roman, l’épaisseur des personnages avec leur violence, leur faiblesse et leur humanité, l’écriture juste et sans fioritures de Claudie Gallay.
SYNGUE SABOUR d’Atiq Rahimi
Fascinée par l’intervention d’Atiq Rahimi lors des « Correspondances de Manosque », j’ai lu son roman avant l’attribution du prix Goncourt.
Syngué Sabour ou Pierre de patience : dans la mythologie afghane, il s’agit d’une pierre magique que l’on pose devant soi et sur laquelle on déverse ses malheurs, ses secrets les plus intimes… La pierre écoute, absorbe les mots comme une éponge puis finit par éclater. Alors, on est délivré.
Rahimi est franco-afghan, réfugié politique,écrivain et cinéaste (prix Un Certain Regard Cannes 2004 pour son film Terres et Cendres). Syngué Sabour est le premier de ses romans écrit en français et non en persan car la langue française lui permet de mieux rentrer à l’intérieur de ses personnages et de parler du corps, dit-il.
Écrit en mémoire de Nadia Anjuman, poétesse afghane, sauvagement assassinée par son mari, le récit se passe en Afghanistan ou ailleurs. C’est un huis-clos fascinant ; Une femme veille et prie au chevet de son mari, guerrier de Dieu blessé et moribond. Peu à peu, elle s’interroge sur sa condition de femme, se révolte contre la guerre, l’obscurantisme religieux, la privation de liberté et de plaisir. Tout en se culpabilisant, elle confie à la « pierre de patience » ( en l occurrence son mari inerte) ses secrets les plus profonds, .sa douleur, se laisse aller à une sensualité réprouvée.
Un livre fort et poignant entre poésie et roman, entre Orient et Occident, une incantation, un cri, une mise à nu,un bel hommage à la femme, une écriture dépouillée, très belle.
Jacqueline MOULIN :
Mon coup de coeur de la rentrée :
LES MAINS GAMINES d’Emmanuelle Pagano
C’est l’histoire d’une souffrance, de plusieurs souffrances, une douleur insupportable à l’oreille, dedans, dehors, un bruit de profondeur… un non-dit qui tourmente celle qui a vu mais n’a rien dit, celle qui a subi et n’a rien dit, celui, le seul, qui n’ait pas participé et qui s’inquiète…
Une écriture fluide, un vocabulaire riche et imagé, une sensibilité à fleur de peau.
à lire et à relire
Anne Currie :
Coups de cœur de l’été :
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES, de Katherine Pancol (Le livre de poche n°30814). Livre qui a reçu le prix de la maison de la presse 2006. Il est question de couples ballotés par les aléas de la vie, de mensonges, de crocodiles… même si l’essentiel de l’action se passe à Paris. Histoire d’amours, d’amitiés, d’argent, de rires, de larmes, pleine d’émotions.
C’est un récit bien emmené et dans lequel on peut se retrouver.
L’AMI BUTLER, de Jérome Lafargue (prix des librairies Initiales 2008), c’est un premier roman d’un écrivain né en 1968. Beaucoup de suspense, récit inattendu et original. En deux mots, il s’agit de l’histoire de deux jumeaux adultes. À la suite d’une querelle, ils restent sans nouvelles l’un de l’autre. Un des jumeaux disparait mystérieusement, l’autre part à sa recherche puis découvre que son frère écrivait sur des auteurs imaginaires. Un des auteurs imaginés arrive en chair et en os pour rendre visite à l’écrivain -son créateur…
La suite est à découvrir en lisant le livre.
Christian Comard :
Notes de lecture
Les vacances, c’est pouvoir lire jusqu’à plus soif. À propos de soif, nous l’avons étanchée au Banquet du livre, à Lagrasse dans les Corbières. J’en ai profité pour des emplettes de livres, beaucoup, pas trop épais en nombre de pages, un peu comme si j’achetais plusieurs légumes peu connus (de moi) pour découvrir d’autres saveurs, varier mes menus.
Je vous livre à domicile mon panier livres :
LE CHEVRON de Pierre Bergounioux chez Verdier, 57 pages,
SENTIERS SOUS LA NEIGE de Mario Rigoni Stern, 10/18, 152 pages,
APPRENDRE À FINIR de Laurent Mauvignier aux éditions de Minuit, 127 pages,
RIMBAUD, LE FILS de Pierre Michon Folio Gallimard, 110 pages,
L’HEURE DU ROI de Boris Khazanov éditions Viviane Hamy, 127 pages.
Le chevron, c’est le mamelon de Corrèze à la hauteur arrondie dont le premier effet est de borner le regard, que l’on pense franchir pour découvrir la voûte étoilée. Mais cette hauteur, que l’on se dit surmontable, apparait comme « une trompeuse espérance ». C’est à l’expérience de cette trompeuse expérience que nous invite Pierre Bergounioux, dans un vocabulaire de ronces, de taillis, d’eau, de routes sinueuses, de fantômes au pays Vert.
Le recueil de nouvelles de Rigoni Stern, situées dans les montagnes de Haute Vénétie m’a ému, notamment la première nouvelle « Comme tu es maigre, frère » évoquant le retour de captivité de l’auteur. Sous la neige vivent ses souvenirs. Pour être plus précis, dire sous ces neiges, des neiges aux noms multiples entre polenta, grand-père, fromage et chevreuils.
Comme un long monologue, le livre de Laurent Mauvignier, du point de vue de la femme. Après l’accident de son homme qui n’en peut plus d’être avec elle, sa femme dans le quotidien du quotidien pense « qu’il ne voudra plus partir : tout ça, il regrettera, il baissera la tête et me dira : promets que nous n’en parlerons plus. Moi, je serai heureuse, je n’aurai plus peur de la maison vide ». Des phrases longues, rythmées par la virgule, respiration, accélérations de la peur, de la haine, de la tendresse, de l’espoir que tout recommencera. Évolution, brouillages, transformation, retours en arrière, reprises d’air, rendus par l’écriture. Puissant.
Qu’est-ce qui fait écrire les hommes ? Pierre Michon avance l’hypothèse que Rimbaud cessa d’écrire « parce que peut-être il ne put devenir le fils de ses œuvres, c’est-à-dire en accepter la paternité ». Rimbaud a jeté bas l’appareil à douze pieds, « la tringle », « a défait le protocole et nous laisse tous sans protocole, impotents et taciturnes comme des meules dans la nuit ». J’arrête mes bruits de mots bien plats pour rendre compte de ce livre. Lisez-le, c’est plus simple.
Je clos mon panier par « L’heure du roi », roman court sans fresques grandiloquentes, économie de moyens pour aller à l’essentiel. Un tout petit pays annexé par le Grand Reich, un roi. Une fable cruelle, terrible sur la responsabilité.
Comme souvent chez les auteurs russes de l’époque soviétique, écrire comme on joue au billard, en faisant des bandes. Le Grand Reich n’est pas que le Grand Reich. La moustache n’est pas que l’hitlérienne. Superbe !
Picorez, piochez comme bon vous semble, de toute façon, c’est du bon !
Geneviève Matray :
TERRE DES OUBLIS de DUONG THU HUONG

Histoire tragique d’une jeune femme vietnamienne remariée avec un homme qu’elle aime et dont elle a un enfant, soudain confrontée au retour de son ex-mari, dont la mort comme héros et martyr avait été annoncée depuis longtemps.
L’auteur évoque avec humanité le passé et le destin de chacun des personnages englués dans une société pétrie de principes moraux et politiques. Cela, dans une langue magnifique où les sons, les couleurs, les odeurs sont intensément présents.
Un livre profond, bouleversant, d’une rare beauté !
Pour moi, il fait partie de ces lectures qui vous accompagnent longtemps après le mot « fin ».
NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU MOQUEUR de HARPER LEE

J’ai beaucoup aimé ce livre, publié en 1960, couronné par le Prix Pulitzer en 1961, livre-culte aux Etats-Unis et dans bien d’autres pays.
Harper Lee situe son sujet dans une petite ville d’Alabama au moment de la Grande Dépression. Atticus Finch élève seul ses deux enfants Jem et Scout. Intègre et rigoureux, cet avocat est commis d’office pour défendre un homme de couleur noire accusé d’avoir violé une jeune femme blanche.
L’histoire racontée avec beaucoup de drôlerie, par Scout, fillette un peu « garçon manqué », tient du conte et du roman initiatique. Cela touche aussi à l’universel car il s’agit de l’enfance confrontée aux préjugés, au mensonge, à la bigoterie, au mal, au racisme.
Presque 50 ans après sa parution, je trouve ce roman d’une actualité saisissante. Et c’est un vrai bonheur de lecture !
Anne Currie :
J’ai beaucoup aimé, dernièrement, le livre de Haruki Marukami, KAFKA SUR LE RIVAGE » édité en février 2006 aux Editions Belfond .
C’est un livre au récit, un peu complexe au demeurant, mais il ne faut pas s’arrêter à cela.
Il est nécessaire de prendre le temps de rentrer dans le roman et là, le lecteur est pris par le récit captivant, surprenant voire inquiétant.
Les chapitres alternent entre trois histoires apparemment sans liens :
– cela commence par l’histoire d’un garçon japonais de 15 ans, fuyant le domicile paternel, pour aller à la recherche de sa mère et de sa soeur, parties depuis longues années,
– puis l’auteur nous parle d’un rapport militaire relatant un évènement ,classé top secret, ayant eu lieu en novembre 1944 au Japon.
– enfin il est question d’un vieil homme japonais, un peu simple d’esprit, qui a le pouvoir de dialoguer avec les chats.
Le thème du voyage est abordé sous plusieurs formes, tant sur le plan du déplacement géographique que celui du voyage intérieur du jeune garçon qui apprend peu à peu à se connaître.
C’est à la fin du livre que tout se rejoint, c’est un roman haletant, très bien construit.
Anne Currie :
Plus léger comme ouvrage, j’ai également apprécié, pour son côté cocasse et quelque peu surréaliste, le livre de Joël Egloff L’HOMME QUE L’ON PRENAIT POUR UN AUTRE éditions Buchet-Chastel.
C’est l’histoire d’un homme au physique commun à qui il arrive quelques anecdotes tristes, voire ubuesques. Cet homme croise un malfrat qui reconnait en lui un ami de déroute.
Des loubards attrapent notre comparse dans une impasse pour le passer à tabac, l’accusant d’une mauvaise plaisanterie.
Enfin, le pauvre homme se trompe de logement et d’étage, en rentrant un soir chez lui.
Il arrive chez une femme, abandonnée par son mari, avec ses deux jeunes enfants à élever.
Cette dernière est persuadée de retrouver son ancien époux, auquel elle est prête à accorder son pardon s’il reste vraiment. Je ne dévoile pas la fin pathétique.
Liliane Matray :
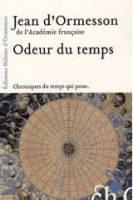
Je viens de terminer le livre de Jean d’Ormesson, ODEUR DU TEMPS et je suis encore sous le charme de l’écriture alerte, gaie, pleine d’humour… montrant une érudition éblouissante. Bref, ce vieux Monsieur m’a charmée.
J’avais lu d’autres livres de lui mais dans ce recueil d’articles écrits pour « le Figaro » à des époques diverses et sur des sujets très variés, vraiment, il m’a convaincue ! Quel écrivain !
Marie-Agnès Chavent-Morel :
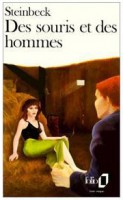
DES SOURIS ET DES HOMMES
Californie, années trente, univers des ranches.
Je viens de relire avec bonheur ce roman de John Steinbeck, écrit en 1937, celui d’une amitié entre deux hommes, Georges et Lennie, nourrie d’un rêve récurrent, répété régulièrement à la manière d’une comptine, par Georges, à la demande de Lennie, déficient intellectuel.
C’est un récit poignant, bref, peut-être une métaphore de la société de l’époque au Sud des Etats-Unis.
C’est un récit tragique, qui débute dans un décor serein, calme, aquatique, les bords de la Salinas et qui s’y termine.
Extrait :
Il s’agit de Slim, l’un des fermiers.
« Ses oreilles entendaient plus qu’on ne lui disait, et sa parole lente avait des nuances, non de pensée, mais de compréhension au-delà des pensées. »
Jacqueline Bonnet-Délétie :

Je termine un livre de Philippe Claudel LE RAPPORT DE BRODECK, prix Goncourt des lycéens en 2007. Cela se passe dans un petit village qui semble se situer en Europe de l’Est, pendant la dernière guerre. À la fin des hostilités, un étranger, “l’Anderer”, l’Autre, débarque et dérange tout le monde par sa tenue, sa grande politesse, ses rares paroles. Il se promène dans la campagne avec à la main un petit carnet noir, sur lequel il fait des croquis, des dessins.
Brodeck, le narrateur est chargé par les villageois d’écrire un rapport, car lui seul a suivi des études. Il doit transmettre aux autorités, un exposé sur un évènement dramatique récemment arrivé au village.
En le rédigeant, Brodeck revit sa propre vie et nous la raconte.
De la page 338 à 347, il y a toute la description d’une exposition de dessins, (portraits et paysages) exécutés par l’Anderer, et les effets terribles qu’ils suscitent chez les habitants du village.
Je n’en dis pas plus.
Les personnages ont de l’épaisseur, les descriptions courtes, les images percutantes, font que je ne me suis jamais ennuyée en les lisant.
Pascale Patrice :
RETOUR EN TERRE, est le dernier bouquin publié de Jim Harrison.

Donald, 45 ans, l’un des personnages de « De Marquette à Veracruz » est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique. Conscient qu’il va mourir, Donald revient sur ses souvenirs et dicte à sa femme Cynthia, l’histoire familiale de trois générations afin de la transmettre à ses enfants.
Pendant ce temps, ses proches luttent pour l’accompagner dans ce voyage qui le mènera à la mort.
Voyage initiatique ?
Chacun(e) fait comme il peut. Tour à tour, les proches racontent, décrivent les émotions qui les traversent face à l’inévitable et l’inacceptable.
Se regarder le nombril, c’est pas l’truc de Harrison. Par contre, il a cette incroyable aptitude à « être au dedans » des personnages qui peuplent ses histoires, et il sait dire le pouvoir apaisant de la Nature. « Retour en terre », c’est un véritable enseignement, sur l’harmonie, l’amour, la vie …
Anne Currie :
J’ai apprécié LA DISPARITION DE RICHARD TAYLORde Arnaud Cathrine, éditions verticales. (Sélectionné dans les dix livres pour concourir au Prix du Livre inter 2007).
L’histoire :
Un homme décide un soir de disparaître, en laissant femme et enfant derrière lui, il ne supporte plus sa vie ordinaire. Le livre est constitué des témoignages de toutes les personnes qui l’ont cotoyé régulièrement (femme, mère, soeur, collègues, amis…).
En filigrane, on devine ce qui l’a poussé à « larguer les amarres.. C’est une situation qui interpelle… un certain nombre d’entre nous ont peut-être été tentés par cette expérience !
Jacqueline Moulin :
UN BALCON EN FORET récit par Julien GRACQ

Grange, Olivon,Gourcuff et Hervouët postés dans les Ardennes ont pour mission d’arrêter les blindés allemands si une attaque se produisait. La « drôle de guerre » est proche, on la sent, on la devine. Les hommes postés dans la forêt semblent suspendus à un temps figé.
Émergeant d’un rideau de pluie, une silhouette vêtue d’une longue pélerine à capuchon nous rappelle que la vie continue. Mais les signes inquiétants se rapprochent…
Une écriture dense, un vocabulaire imagé.
Yanik Vacher-Letellier :
BORD DE MER de Véronique Olmi (Actes Sud et en poche)

Très court roman, dense et intense, dont il est difficile de donner le fil de l’histoire sans le trahir. Une femme au bout du rouleau et ses deux enfants, dans une petite ville, la mer l’hiver. Ils attendent. C’est bien cela et rien de tout cela à la fois.
À lire absolument. Véronique Olmi, auteur de théâtre, écrivait là (en 2001) son premier roman. Depuis, les romans qui ont suivi n’offrent pas, à mon sens, autant de magie et de violence que celui-ci.
LA MONTEE DES EAUX de Thomas B. Reverdy (Seuil)
Tout d’abord, les phrases paraissent longues. Très longues. Elles sont longues. Puis elles reviennent à une structure plus habituelle. Je ne l’ai pas lu d’une traite. Je l’ai lu par bouts, le laissant de côté par moments pour y revenir. Plusieurs beaux passages ou moments lors de la rencontre avec Eléonore : on se retrouve face à une description du lieu, des sensations qui se font jour à ce moment. Il apparaît une dimension un peu naïve comme si, pour la première fois, le personnage principal vivait un coup de foudre.
Dans les 27 premières pages : 3 rythmes différents, 3 « vies internes » différentes pour un seul et même personnage : de la douleur d’être un petit garçon perdu après la mort de sa mère ; l’amoureux transi ; le pote. Alternance entre le je (l’amoureux) et le il (le petit garçon).
Le retour, sa présence dans l’appartement après le décès de sa mère est entre 2, entre 2 eaux, entre lui et elle.
Passage impressionnant de sensualité violente, énorme, lors de la « rencontre » amoureuse. L’alternance entre le je et le il renvoie au petit garçon et à l’homme, qui n’en finissent pas de se heurter.
Dépeint le corps d’Eléonore jusque dans les moindres détails.
Le côté « tempête » semble prendre toute son ampleur en introduisant la dimension d’anticipation. Repousser l’événement inéluctable (la mort de sa mère) ? Luxe de détails et de précision avec une pudeur sans cesse là, présente. Beauté du texte ? Rendu précis, par touches, du malaise d’une époque, d’une génération.
SOROR de Christian Laborde (Fayard)

Il me semble avoir lu ce livre dans une demi-conscience, dans un demi-sommeil. Il me semble avoir frôlé un monde parallèle où existent la poésie, le charme et le surnaturel. Comme un peu d’anticipation sur notre propre monde qui se détruit lui-même. (Fayard)
LA CLOCHE DE DETRESSE de Sylvia Plath (Gallimard – collection Imaginaires)

Douleur de l’acte de création, douleur et difficulté à essayer de vivre, de s’affranchir de ses fantômes, celui du père en l’occurrence. Beau et désespérant. Lu car j’aime beaucoup la poésie qu’a pu écrire Sylvia Plath (poète américaine, décédée dans les années 60). (Gallimard – collection Imaginaires)
Christian Comard :
LE MONT ANALOGUE de René Daumal (Gallimard, coll. L’imaginaire, 1981.)

Tout le monde sera d’accord, la vie est une longue marche, bourrée de chausse-trappes.
Est-il possible de « marcher droit », « être d’équerre » quand on sait qu’au bout c’est le grand saut ?
Comment être debout, les pieds dans la réalité humaine, la tête tutoyant les cimes fuyantes, domaines des dieux, de leurs mythologies ?
Relier le mortel au divin, n’est-ce pas ce qui nous constitue homme ?
Les sommets terrestres devenus des « montagnes à vaches » (plus ou moins), existe-t-il quelque part une montagne dont le sommet soit « inaccessible par les moyens humains ordinaires » et cependant avec une base accessible aux humains tels que la nature les a faits » ?
René Daumal (qui connaît René Daumal ?) nous propose son « Mont Analogue » qui existe géographiquement sur notre terre. On pense, il est fou ce type, il marche de travers, il délire. Et oui, il délire, du moins le narrateur délire et le père Sogol délire. Mais est-ce délirer que de ne pas se satisfaire de la géométrie euclidienne ?
Suivez les aventures du père Sogol et de son expédition, à la découverte de ce mont Analogue où vous verrez qu’il faut être un peu « tordu » pour rencontrer d’autres humains, d’autres paysages, d’autres civilisations.
Le roman de René Daumal est inachevé. René Daumal est mort tuberculeux en 1944 sans avoir pu terminer l’écriture de la relation de son expédition « symboliquement authentique ». Ultime pied de nez au monde fini dans lequel nous évoluons ?
Cette littérature nous ouvre à la courbe et c’est ironique, drôle, savant, banal, émouvant, catastrophique. Quelque chose échappe… Pas belle la vie ?
Pascale Patrice :
LE CŒUR COUSU de Carole Martinez

« Écoutez, mes sœurs !
Écoutez cette rumeur qui emplit la nuit !
Écoutez… le bruit des mères !
Des choses sacrées se murmurent dans l’ombre des cuisines. Au fond des vieilles casseroles, dans des odeurs d’épices, magie et recettes se côtoient.
Les douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné le cœur. Leurs plaintes sont passées dans les soupes : larmes de lait, de sang, larmes épicées, saveurs salées, sucrées. Onctueuses larmes au palais des hommes ! »
Frasquita Carasco a dans son village du sud de l’Espagne une réputation de magicienne, ou de sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements qu’elle coud, aux objets qu’elle brode : les fleurs de tissu créées pour une robe de mariée sont tellement vivantes qu’elles faneront sous le regard jaloux des villageoises ; un éventail reproduit avec une telle perfection les ailes d’un papillon qu’il s’envolera par la fenêtre ; le cœur de soie qu’elle cache sous le vêtement de la Madone menée en procession semble palpiter miraculeusement…
Frasquita a été jouée et perdue par son mari lors d’un combat de coqs. Réprouvée par le village pour cet adultère, la voilà condamnée à l’errance à travers l’Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang, suivie des ses marmots eux aussi pourvus — ou accablés— de dons surnaturels…
Le roman alterne les passages lyriques et les anecdotes cocasses ou cruelles. Le merveilleux ici n’est jamais forcé : il s’inscrit naturellement dans le cycle tragique de la vie.
Carole Martinez est née en 1966, « Le cœur cousu » est son premier roman.


