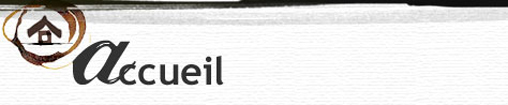Je reçois un lien me permettant d’accéder à des vidéos enregistrées lors des noces d’or d’amis de longue date. Sur l’un de ces enregistrements, un drone transmet la prise de vue aérienne de notre groupe accompagnant nos mariés de 50 ans à la petite chapelle où ils se sont unis. Le sanctuaire de Saint-Genès se trouve sur le plateau du Larzac, perdu au milieu d’étendues âpres, piquées de rochers calcaires, au milieu d’immensités où règnent l’asphodèle et la cardabelle, dans un pays de rocaille, de genêts et de buis…
Je visionne la séquence. Soudain une voix jeune s’élève dans ce contexte tourmenté. L’inflexion de cette voix me fascine. Un Hallelujah brisé, d’une mélancolie absolue me prend aux tripes. C’est d’un timbre très pur qu’une adolescente livre une interprétation personnelle de cette musique traditionnelle*. Voix puisée dans la douleur, voix qui se tend, qui s’arrache du cœur de la jeune fille. Un accord majeur s’élève, en communion avec le cortège qui suit les époux vers leur Terre Promise, en accord avec leurs promesses d’alors. La musique prend possession de tout mon être. Les deux couplets, sublimes, ne traduisent pas la louange au Seigneur classique. Plus qu’un véritable sacerdoce, le chant résonne en moi comme un hymne universel dédié à l’Amour, une prière profane et cela, dans une allégresse totale. Au-delà de l’incantation mystique connue de nous tous, là, c’est une ode qui résonne, ode à la durée de cette union, à la fidélité d’un engagement ancien. Il y a 50 ans, les jeunes mariés sont venus en ce lieu loin de tout, ont marché sur ce sol aride.
Beau clin d’œil familial qui se termine par le survol d’une lavogne qu’une source alimente, le tout en accord avec le Causse à la végétation rabougrie mais ô combien résistante au temps…
La voix fraîche du chœur s’est tue…
24 juillet 2018-08-21 (* Hallelujah de Jeff Buckley, 1994)