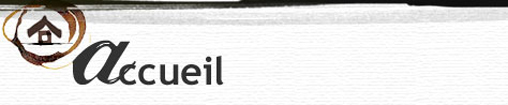Un feu de camp dans le Yosémite. L’odeur âcre du bois pourtant sec. Le feu pétille – rubans de fumée, volutes élastiques autour des branches. Sous ce ciel d’été profond, le clignement des étoiles éveille en elle ces instants d’été au Prège, lieu de son enfance.
Dans une réserve de chasse forestière, le pavillon à l’abandon avait été une aubaine pour ce premier amour étudiant. Elle avait rencontré Charles après sa réussite au concours d’École du Cinéma. Quel enthousiasme alors ! Concrétiser ses rêves de toujours. La famille avait longtemps douté de son choix. Ils la connaissaient rêveuse, passionnée de photo, sans cesse à filmer depuis que son frère lui avait donné une caméra, à filmer la famille, au quotidien. Photo et caméra, elle les avait autour du cou dès qu’elle se déplaçait, se baladait dans la campagne.
Jeune adolescente, combien de fois avait-elle été transportée en lisant Lancelot du Lac dans une ancienne édition cartonnée. Assise dans les joncs, au Prège, un plan de baignade où d’énormes pierres joufflues retenaient les eaux vives de la Semène. Maud résistait aux taquineries joyeuses et rafraîchissantes de ses camarades qui auraient aimé l’entraîner dans leurs jeux d’eau. Le bois de la Fressange, près de chez elle, lui servait de décor pour de grandes fresques de reconstitution de cavalcades de chevaliers traversant les forêts pour des guerres seigneuriales sans merci. Il y avait ces galops-là. Et parfois, Lancelot lui-même, sans casque, cheveux au vent, égaré dans cette forêt bruissant de mille sortilèges, s’imposait sur un cheval piaffant et cliquetant de blanc. La jeune princesse, dans sa robe longue, légère et soyeuse, fluide dans le vent, couronnée de fleurs des bois, surgissait, puis disparaissait quand Lancelot croyait la rejoindre.
Combien d’heures n’avaient-ils pas discuté avec Charles, des plans, des couleurs, des jeux de saisons pour mettre en valeur la beauté du sous-bois ? L’éclat de la neige, les brumes cotonneuses de printemps, le jaillissement net des genêts en fleur, la touffeur de l’herbe, l’été, quand le souffle chaud de la terre est vite rabattu par la caresse d’un vent frais. Comment filmer le goût très doux des myrtilles, au violet sobre et subtil ? Leurs discussions enivrantes, leurs premières approches de la technique, les portaient loin dans la nuit. Éclairés par l’incandescence des braises, ils écoulaient leur provision de babets et branchages, grillaient quelques saucisses en buvant des alcools forts. Vieux marc, vin de noix ou d’orange.
Leur idylle n’avait pas duré très longtemps. Une jeune, entêtée de politique et d’avant-garde, avait rapté Charles à Maud. Elle avait travaillé plus dur. Cela avait été une chance. Elle avait été reçue première de sa promotion, tout de suite remarquée par le producteur qui avait ses entrées à Hollywood.
Comment résister à ce succès ? Un mari informaticien de talent, deux enfants, prolongeaient les maillons de son bonheur. Dégagée d’obligation financière, elle s’adonnait à la création sans complaisance. Son côté trop frenchy l’avait écartée des grandes productions. Elle avait alors eu tout loisir de peaufiner son œuvre « À la poursuite de Lancelot ». Sélectionnée à Cannes, elle s’était taillé un joli succès auprès des médias français. Charles, s’était orienté vers les documentaires, elle n’avait plus entendu parler de lui.
Après le succès du film, elle avait pris des vacances avec son mari et les enfants, tous les trois comblés par sa présence. Elle avait parfois la nostalgie de sa Haute-Loire, bigrement inexistante de ce côté de l’Atlantique ! Ils avaient de longue date, programmé un voyage familial en Haute-Loire. Ses filles comprendraient-elles cette nature rauque ? Elle leur lisait beaucoup d’histoires en français, celles qu’elle avait adorées. Pour « Lancelot », elle avait attendu qu’elles entrent en adolescence.
C’est de retour de ce voyage à ses sources françaises que la famille avait sombré en mer lors du crash de l’avion. Seule, la plus jeune des filles a survécu. Elle vit dans les brumes de la côte est.
Elle écrit des Bandes Dessinées futuristes, le héros, un Lancelot du troisième millénaire.