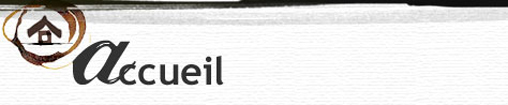La chevalerie, la voie droite, le château perché ?
Le laurier courbe s’élance vers le ciel, pose la question.
L’amour galant, le chemin sinueux, la maison ?
L’adoubement.
Mes ancêtres me précédent sur la route ouvrant la carrière. Mon père m’a donné l’armure et l’épée. Le laurier tremble aux premières lueurs de l’aube. L’amour galant déroule au chevalier une autre voie. La belle m’a offert un bouquet de fleurs. J’ai orné mon casque d’une tresse de ses cheveux. Sous le casque, ma tête si forte, si fragile, seule sur le chemin, avec mon casque et mon armure, elle chevauche jour et nuit, aspirant de sa quête. Le laurier se redresse, me coupe en deux. Sous ma chemise, mon cœur si gonflé, si vibrant, il est endormi, bercé du beau souvenir, il attend le retour de la belle. Elle le mettra à nu.
Mon corps guidé par ma tête, poursuivant son chemin glorieux, sera l’arme de la Justice, la mort de ses ennemis, Il rendra coup pour coup, défendra les faibles et les orphelins. Le laurier vibre, ses feuilles tremblent. Mon corps, animé par mon cœur, couché au creux du corps de ma belle, restituera sa chaleur, caressera ses cheveux. Il se donnera tout entier, apportera le bonheur à la femme et à l’enfant. La coupure vaine est mortelle.
Que peut être un chevalier sans cœur ? Mon cœur, ma tête et mon corps se chercheraient, sans répit, jusqu’à la mort. Le laurier oscille de droite et de gauche sous le souffle du vent. La belle unité est source de vie et de paix. Que ferait ma belle d’un cœur sans tête ? Mon corps, ma tête et mon cœur chevaucheraient ensemble. L’aube se lève. Le soleil ouvrira mes paupières. Le laurier se redresse droit, solide.
En m’allongeant au pied de l’arbre, n’avais-je pas déjà choisi ?