C’est la première fois que Monsieur Jean me sort de mes montagnes et m’emmène quelque part. Je suis dans ce qu’on appelle une ville, en haut d’un bâtiment, devant une grille, accroché à une barrière, en face d’une sorte de terrain vague.
À cette heure-ci le ciel est bleu, pas de vent, quelques oiseaux qui volent ici et là. En voilà un énorme qui arrive. Soudain un bruit fracassant me secoue le corps. D’où vient-il ? Je me tourne et me retourne et subitement, devant moi, l’énorme oiseau semble avoir du mal à marcher.
Comment et avec quoi peut-on blesser un si gros oiseau? Qui a pu faire une chose pareille ? Ce ne sont pas les petits diables de mes voisins, leur lance-pierre ne suffirait pas pour faire tomber un oiseau de cette taille.
L’oiseau approche. Mes mains tremblent, je tremble tout entier: Mais ce n’est pas un oiseau ! Il a la tête plus haute qu’un cocotier, le ventre plus gros que tous mes baobabs réunis, les ailes plus étendues que mon champ de blé, ses pieds n’ont ni orteils, ni ongles.
Décidément, non, ce n’est pas un oiseau. C’est une Chose, là, au milieu du terrain vague, qui vrombit, gronde, agonise, avec ce bruit aussi puissant que les alizés dans la forêt de bambous. Tout le monde s’est retiré, loin de la chose.
Le bruit s’arrête et on se précipite. La Chose est morte, on va à son secours. On apporte des échelles pour monter sur son dos. Il ne doit pas y avoir d’échelle assez haute. Ce qu’ils ont trouvé comme échelle arrive à peine au milieu de la tête de la chose et au milieu du ventre. Des pompiers s’approchent, ou des médecins, en tout cas ils ont les mêmes vêtements. Deux courageux gravissent les échelles, montent jusqu’au bout, auscultent la Chose, regardent partout et tapotent la peau de la Chose, rien ne bouge. Elle est bien morte. Les deux courageux crient quelque chose à leurs collègues qui n’ont pas osé monter sur l’échelle et ils ne s’aperçoivent plus de ce qui se passe derrière eux.
La Chose vient de se trouer à l’endroit où les échelles sont posées, laissant passer deux sortes de gros insectes, noirs et gesticulants.
Des humains sortent du ventre de la Chose et empruntent l’échelle !
Monsieur Jean m’appelle, il est temps de partir. A-t-il vu ce que j’ai vu ?
Des humains dans le ventre d’un gros oiseau mort. Ça alors ! Comme ils ont du souffrir !
Je me rappelle l’histoire de la baleine qui avait avalé la pirogue et les deux pêcheurs. On a dû pêcher la baleine pour les sortir de là.
— As-tu vu ce que j’ai vu, Monsieur Jean ?
— Quoi ?
— La chose, le gros oiseau ?
— L’avion ?
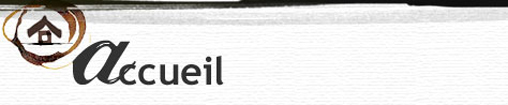
« La chose »
« Souvenir de lectures »
« Françoise ! Que fais-tu ? Pourquoi ta lampe est-elle encore allumée ? »
Ma grand-mère et sa fille revenant d’un office religieux du soir avaient été surprises de voir la lumière dans ma chambre. Elles m’avaient laissée seule dans la grande maison. Je n’avais pas peur ou plutôt je n’y pensais pas car pour peupler ma solitude, j’avais une collection soigneusement reliée de « Semaines de Suzette », journaux pour les fillettes, qui dataient de la génération de mes parents.
Cette collection m’a tenu compagnie tout l’été. Chaque numéro commençait par une sorte de BD moralisante où les petites filles des illustrations portaient des robes démodées. On passait ensuite à une longue histoire à épisodes avec quelques rares illustrations en noir et blanc. Illustrations qui ne m’étaient pas nécessaires, j’étais captivée. Il s’agissait en général d’enfants qui se retrouvaient seuls et qui se débrouillaient comme des héros dans des situations difficiles.
C’est ainsi que j’ai divagué sur un bateau perdu dans la mer des Sargasses. Communiant avec Aliette, une fillette de mon âge aidée par un garçon très gentil, je tombais amoureuse de lui.
Les enfants se conduisant en héros étaient mon thème favori. Ces histoires laissaient souvent prévoir un mariage d’amour pour plus tard…
J’ai lu par la suite, au moment de la Libération, l’histoire d’enfants isolés qui avaient caché un parachutiste anglais, assez jeune pour rêver de se marier avec la petite-fille qui l’avait recueilli. Ce feuilleton avait pour titre : « Tous seuls ».
Et moi, avec mes lectures, je n’étais jamais seule !
« La grande route »
Cotonou Parakou, environ 400 kms sur un axe nord sud. Vous emprunterez une large route le plus souvent goudronnée, parsemée d’ornières et de troncs d’arbres installés en travers par les villageois, soucieux de ralentir la vitesse des véhicules. Vous côtoierez de grands camions en transit pour les pays voisins, des mobylettes antiques emportant des familles nombreuses, des 404 dégingandées, bringuebalantes, toutes sortes de véhicules engorgés, rapiécés et bondés.
De part et d’autre de la route, vous regarderez les villages qui s’enfoncent dans la brousse, les maisons rectangulaires en briques de terre crue, les greniers à céréales, les toits couverts de tôles ondulées ou de végétaux séchés, de grands arbres à l’ombre épaisse.
Pour le bonheur des yeux, en cette saison des pluies, la terre ocre rouge jouera avec les nuances vert cru de la végétation. Vous ne connaîtrez quasiment aucun arbre si ce n’est la silhouette élancée du mythique baobab.
La foule en boubous colorés vaquera à ses occupations, marchands de fruits et de légumes, d’arachides, fabricants de canapés et de cercueils, maquis, boutiques de coutures, de coiffures, vendeurs d’essence. Emmanuel, le chauffeur de votre bus, évitera d’un habile coup de volant la collision fatale à quelques chèvres naines. Vous tacherez de vous habituer aux rires étonnés ou aux pleurs terrifiés de certains petits enfants qui n’ont jamais vu d’humains à la peau claire.
Il y aura des « Yovos » à la volée, ce qui signifie « blancs ». Vous vous sentirez très pâles.
Dans le bus d’Emmanuel, les fenêtres seront grandes ouvertes. Il faudra contracter un peu les muscles et ne pas trop vous assoupir afin d’éviter le coup du lapin ou de vous démettre les vertèbres, pas d’appuie-tête ni de ceinture de sécurité.
Vous vous accommoderez des remontées d’essence du moteur et vous demeurerez paisibles entre les mains de votre émérite chauffeur.
Parfois le bus stoppera pour une pose pipi. Certains hommes, béninois, s’accroupiront au bord de la route. Les femmes descendront le talus instable pour rejoindre courageusement les fourrés mystérieux. Vous prendrez garde à ne pas utiliser les feuilles prises au hasard, épaisses, piquantes, abrasives, étonnantes.
Peut-être voyagerez-vous sans bagage si la compagnie aérienne les a perdus. Vous ne craindrez pas cette expérience à priori déroutante. L’immersion dans cette nouvelle vie n’en sera que plus efficace.
« Mai 68 »
Lui, vaque à ses occupations selon la routine quotidienne. Il accompagne ses enfants à l’école en partant travailler. Il n’imagine pas ce qui va se passer en un mois.
La radio, ce matin-là, annonce une manifestation d’étudiants à Paris. Rien de grave, cela est fréquent et Paris, c’est loin. Le lendemain, l’information prend plus de place dans le bulletin de treize heures. On apprend que les CRS sont sortis de leur caserne. La protestation se communique aux entreprises. Les grèves s’étendent. Les usines et les bureaux sont occupés par les grévistes, jour et nuit.
Lui, est insouciant, en province les troubles ne l’atteignent pas. Les propos des étudiants sont accueillis avec sympathie. Dans l’euphorie générale, il a l’impression de vivre un rêve éveillé, plus de contraintes. Le monde va changer. Il prend la parole, dans la rue, s’adresse à un voisin ou à un inconnu comme si c’était un ami. Il a l’impression de revivre la liesse de la libération en 44. Ce climat va durer quelques jours.
La radio annonce que les manifestations s’amplifient, le mouvement se transforme en grève générale, plus de trains, plus de transports en commun, la poste et les journaux emboîtent le pas. Les écoles ferment, faute de cantines et de transports scolaires. Les camions-citernes sont bloqués dans les dépôts. Les pompistes, après avoir vidé leurs cuves, affichent : « Plus d’essence ». À Paris, la manifestation tourne à l’émeute, on a dressé des barricades, coupé des arbres, arraché des pavés.
Lui, a du temps de libre pour vivre avec sa femme et ses enfants, sans travail, sans école, sans obligation, sans inquiétude, comme en vacances. Il prend son temps et fait la queue devant l’épicerie. Des ménagères paniquées se surchargent de sucre, de café, d’huile, de peur d’en manquer. Elles participent à créer la peur et la pénurie. Bientôt le réapprovisionnement des petits commerces ne se fera plus, l’épicier s’inquiète et baisse sa grille.
La radio confirme que ce climat s’installe dans la durée et s’étend à toute la France, il y a même quelques remous à l’étranger. Il n’y a plus d’État, plus de services publics. Les policiers et les gendarmes sont invisibles. Le gouvernement est impuissant, il ne fait rien ou s’il fait quelque chose, cela échoue ou reste invisible. Le pouvoir est vacant. Qui va le prendre ? Toutes les rumeurs circulent. Personne ne sait ni quand ni comment se sortir de l’impasse.
Lui, sort dans la rue, en quête de nouvelles sur la ville et la région ; pas de voitures, des piétons, quelques cyclistes qui ont sorti leurs machines rouillées des remises. Tout à coup, dans un grand crissement de pneus, une traction-avant noire, occupée par quatre hommes, passe en trombe sur le quai du Rhône. Sur la portière, trois grandes lettres peintes hâtivement au blanc d’Espagne : CGT. Il ne peut s’empêcher de sourire en voyant ces quatre jeunes qui rejouent la scène qu’ont vécue leurs aînés en 44 avec la même voiture symbolique et les lettres FFI. La lassitude le gagne peu à peu, comme sa famille et ses voisins d’ailleurs. Il est convaincu que cette situation ne peut pas durer éternellement.
La radio annonce que le gouvernement et le premier ministre ignorent où est le Président de la République. Stupéfaction ! Il n’y a plus personne au gouvernail. Bientôt tout s’accélère : Retour, discours, contre-manifestations. On annonce une grande concertation. La vie reprend. Le nom de « Grenelle » va entrer dans l’Histoire, ce nom d’un quartier de Paris deviendra le symbole des grandes remises en question. On dira le « Grenelle de ceci », le « Grenelle de cela », chaque fois qu’on voudra donner de l’importance à l’annonce d’un événement.
Lui, vaque à ses occupations selon la routine quotidienne. Il accompagne ses enfants à l’école en partant pour travailler.
« L’homme qui marche » (Giacometti)
Mes yeux vont vers toi, être mince et infini.
Tu marches sans bruit,
Tu ne te retournes pas.
Tes jambes si hautes paraissent vouloir marcher
éternellement…
Je me surprends à emboiter ton pas
au même rythme que toi.
Je t’accompagne dans ton extrême solitude,
la mienne s’y reconnait.
Tu t’es délesté du poids de ton corps,
tu t’es débarrassé du superflu.
Seul ton visage porte la trace d’un appel,
d’un cri lent et douloureux,
d’un passé lourd et épais.
Le poids de ta vie plombe ta démarche.
Tu as du mal à soulever les pieds,
tu t’embourbes dans l’abîme des jours.
Mes mains passent sur le bronze:
ton métal est presque humain.
Etre filiforme, tu es humble.
Je me sens proche de ton silence.
Pourtant ta présence m’intimide.
Peut-être ta fierté inquiète ?
Tu as beau être inanimé et froid,
je capte la détresse de ton regard.
Seras-tu jamais en paix ?
De la matière inerte me parviennent
tes appels de détresse.
Présence familière,
profil voué au désespoir,
regard triste creusé dans le plein du métal,
je voudrais te saisir,
te redonner de la chaleur,
adoucir ta peine profonde.
Je voudrais alléger ton fardeau…
Que la sérénité te gagne,
qu’une paix intérieure t’enveloppe,
que tu te délestes de ton habit chargé de malheur.
Etre pathétique…
Je te prendrais par la main,
je décollerais tes pieds du sol,
nous cheminerions ensemble
vers une destinée lumineuse.
« Les toiles du temps »
Derrière la rouille de la croisée
mon regard suit le halo irréel
qui l’attire dans un monde
à l’abandon.
Je me refuse à n’y voir que les roses d’un autre temps.
Je me fonds avec langueur dans leur transparence.
Mes yeux se brouillent.
Tout est si confus…
Un voile épais de toiles d’araignées
s’ingénie à réduire ce jardin d’autrefois
à une photo surannée…
Blottie dans l’épaisseur de l’encadrement de ma vie,
la fragilité de ce monde diaphane
me saute aux yeux.
Roses délicates, prisonnières du destin,
Roses que je ne peux laisser engloutir par l’oubli…
Mon regard s’appesantit
sur cette source lumineuse diffuse…
J’y devine le reflet flou de nos visages.
Je reste perplexe sur la fragilité du souvenir.
Le clair-obscur favorise une trouée dans cet enchevêtrement.
Nos ombres s’y perdent pour mieux s’y rejoindre.
Elles se fondent l’une dans l’autre
à l’infini
dans notre solitude à deux,
intimement…
« Couleur violette »
Pour toi, des mots
sur la page blanche à l’encre violette.
Pour toi, de lourdes grappes mauves de lilas
gorgé de pluie où j’ai piqué quelques iris de Hollande.
Pour toi aussi, ces longues hampes odorantes
de notre jeune glycine bourdonnante d’abeilles.
Et nos touffes de lavande…
J’en égrènerai les épis pour parfumer nos armoires.
Pour toi surtout, cette confiture de figues violettes
saturées en sucre et les premiers grains de raisins de notre Treille Muscate. Ils éclateront dans ta bouche.
Pour toi encore, la violine des cieux de Chalencon
au soleil couchant où se glissent des touches saumon au-dessus de la vallée de l’Eyrieux.
Pour toi aussi, les reflets violets dans le creux de la vague
autour du catamaran sous les étoiles.
Pour toi enfin, le mauve de la montagne
qui vire au violet sur le désert du Sinaï…
Qu’importe si ce sont des mains violacées, rugueuses,
gercées par la vie qui continuent à te les offrir
n’est-ce-pas ?
Qu’importe puisque ces mêmes mains t’avaient tendu
un bouquet de violettes fraîchement cueillies au début du printemps, sur les talus au soleil
n’est-ce-pas ?
« Haïkus d’automne »
Figues mûres perlées de miel
La fin de l’été
fait d’illusoires promesses !
Il fait tanguer les herbes folles
rapide comme l’anguille
le chat surpris par la pluie !
2014 « Le détour »
Un détour par Arnas, dans le Beaujolais.
« La Petite »
Claudine Genet
Elle ne s’appelle pas, elle ne s’appelle plus. Son nom, plus personne ne le prononce dans le village. Elle est la Petite.
Un jour, elle a découvert l’océan, impressionnée par ses vagues. Elle laissait la fenêtre de sa chambre ouverte et elle respirait avec lui.
Un jour, elle était sagement assise entre père et mère sur la plage.
Un jour et un autre jour, ainsi jusqu’à la fin des vacances et les sui-vantes, le plus souvent sans son père.
Un jour, fluette dans sa petite robe fleurie, sautillant comme ces enfants qui portent en eux la joie de vivre. Les gens du village l’ont connue comme ça, la Petite.
Un jour, elle tenait la main de sa mère, elle s’échappa et rejoignit ses amies, des filles du village. Elle était la plus jeune et Chloé l’ainée, Cora avait déjà la fibre maternelle et Léa jouait l’indifférente.
Un jour, les gens du village ne l’ont plus vue courir sur la plage et se jeter dans les vagues avec entrain.
Un jour, elle a choisi de suivre ses études dans la même ville que Léa. Elles ont pris une colocation.
Un jour, elle a coupé ses cheveux pour faire plaisir à son amie.
Un jour, une soirée, jupe rouge et débardeur près du corps, elle dansait avec Léa, elle dansait inondée de plaisir, sur une musique déchaînée.
Un jour ou plutôt, cette nuit-là, elle est rentrée chez elle avec son amie.
Au jour, elle était deux dans son lit. Son corps satisfait, ses bras autour, son visage contre son cou.
Un jour, elle a pleuré, ses yeux bleus ont viré au gris. Son père l’obligeait à rentrer à la maison. Elle s’est demandé où était sa maison.
Un jour, elle s’est tu et sa mère a insisté sans succès, pour rien.
Un jour, elle a retrouvé ses amies : Chloé, Cora et Léa. Elle a passé tout l’été avec elles. Elle a bruni, ses cheveux ont blondi. Elle est devenue experte en pêche aux moules et aux coques avec l’aide de Léa.
Un jour, elle a pêché en mer avec un vieux marin, le père de Chloé, et Léa bien sûr. Silencieux, il était aussi son confident, comme pour Léa.
Un jour, diplôme en poche, elle s’installa dans la maison de la grand-mère de Léa.
Un jour, elle se boucha les oreilles, elle refusait d’entendre son père dénigrer ses amies, surtout Léa, dans sa grande maison au-dessus de l’océan.
Un jour, elles sont allées sur l’île, à une demi-heure de la côte avec le bateau du vieux marin. Chloé était devenue marin, elle aussi. Léa est restée à l’avant, elle regardait l’océan, comme si personne d’autre n’existait.
Un jour, elle s’est senti très seule. Léa est partie faire le tour de l’île sans elle. Elle n’a pas compris. La soirée passée autour du feu, elle s’est couché solitaire.
Un jour, au lever, elles étaient trois. La Petite avait disparu, ainsi que l’annexe qui servait à rejoindre le bateau.
Un jour, les gens du village ne l’ont plus revue. Son père les a maudits et Léa, encore pire, du haut de son rocher.
Chloé navigue sur les mers, Cora s’est installée avec son mari et Léa parcourt le monde. Elles attendent le retour de la Petite.
« Un jour »
Annie Maréchal
Un jour Pépé, assis derrière la fenêtre, vêtu du pullover Tricoté et rapiécé par mémé,
Un jour où il lit le journal déposé la veille par les voisins.
Un jour différent, pépé ronchonne, il supporte mal la chaleur même après
Une longue sieste.
Un jour, pépé ne peut se lever, sa canne est tombée, la fenêtre reste fermée.
Un jour pépé se sent seul, mémé est allée au cimetière, il n’aime pas que mémé s’absente.
Un jour sans jardinage, (c’est comme un jour sans pain dit-il !), pépé soulève son béret
Et aère son crâne, s’essuie le front avec un large mouchoir à carreaux.
Un jour qui entend la grogne de pépé, un jour qui pèse.
Un jour qui le cloue à sa chaise, il s’ennuie, la radio est éteinte personne pour tourner le bouton inaccessible
Un jour, Pépé entend un randonneur qui frappe et demande de l’aide.
Un jour où Pépé en manque d’amabilité et d’énergie ne réalise pas.
Un jour Pépé a laissé la bouteille de son propre vin, entamée, sur la table, une mouche s’amuse
Sur la toile cirée décolorée.
Un jour où Pépé et le randonneur partagent le verre de vin légèrement aigre
Un jour qui coupe la routine estivale et pépé boit, ses moustaches rougies
Gouttent sur le pullover.
Un jour ses pieds enflent, Pépé délace son unique paire de chaussures, ressemelées par ses
soins et portées hiver comme été.
Un jour d’été orageux, mémé est revenue, Pépé n’est pas rasé.
Un jour où mémé prépare un gros potage, elle prétend que la quantité attire les invités,
Et pépé s’étonne : « ce ne sont que des balivernes »
Un jour où une forte pluie s’abat sur la route qui passe devant la maison, un arc en ciel se forme aussitôt.
Un jour où les enfants sont en vacances, l’arrière-petit-fils de pépé arrive.
Un jour d’émotion, pépé éteint sa pipe, son sourire étroit écarte sa moustache.
Le mouchoir à carreaux sèche la goutte qui coule sur la joue.
2013 « Le silence… l’écrire »
En silence à Demigny, en Bourgogne.
Chouski MARICHAL
Testament d’un Chartreux Bouddhiste
Nous léguons tout ce que nous possédons à la douleur du monde.
Voici nos derniers mots :
Nous avons fait vœu de silence.
Faire silence, vivre en silence, vivre dans le silence.
C’est un engagement, sur une voie silencieuse.
Pour :
Infléchir le fracas des armes,
Frémir du hurlement des martyrs,
Recevoir les pleurs des affligés,
Respecter la plainte du petit,
Porter le faible,
Soutenir l’opprimé,
Laisser la parole aux censurés,
Expier les mots trop lourds, les mots trop vides,
Respirer l’air qui vibre de tous ces sanglots,
Panser les blessures de la condition humaine,
Entendre les pleurs et les grincements de dent,
Recueillir les larmes à leur source jamais tarie,
Accueillir les désespoirs dans l’immensité limpide d’un univers de silence,
Offrir à la souffrance du monde un écrin de respect.
Silence :
Nous ne parlons plus,
Nous ne faisons plus de bruit,
Nous ne créons plus de sons,
Nous marchons en silence,
Nous mangeons en silence,
Nous respirons en silence,
Nous offrons notre silence.
Oraison muette, écoute attentive du murmure des étoiles,
L’âme tendue vers la supplication de la multitude
En communion avec l’affliction du monde.
D’hier, d’aujourd’hui et de demain, d’ici et d’ailleurs.
Silence dans nos têtes, silence dans nos âmes.
Paix au vacarme intérieur.
Aucune lecture, aucune écriture, silence de papier
Silence des objets, même eux ne parlent pas.
Bienheureux silence des corps, santé, sérénité.
Capter les sons les plus ténus, sans les nommer ;
Ecouter les sensations les plus subtiles sans les nommer ;
Observer les êtres, les objets et les concepts sans les nommer.
Quitter les mots
Oublier nos mots, oublier les mots, de quelque peuple qu’ils viennent :
Revenir à la genèse des choses avant que l’homme ne les nomme.
Le silence lui-même n’a plus de nom.
Vivre dans ce silence où se brode l’infime son du souffle de la vie.
Tout a été dit, revenir au silence.
Une fois par an, au solstice d’hiver, sous la hauteur glacée de la voûte de pierre,
nous chanterons le De profundis
En une profonde et grave clameur, nous enverrons vers le ciel l’écho de ces douleurs.

