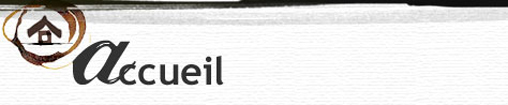Douce musique
Balancement du bras
Les bras enlacés
Les vieux rideaux du château
Nostalgie
Cette voix qui vibre et se balance
Une présence d’autrefois et une mélodie-peinture
Des bleus et des roses
Mais le soleil couchant et les caresses de la main sur les cordes
Du pinceau sur la toile
Du regard sur un visage
La musique s’est envolée
Les doux instants prennent place au salon.
Libre comme l’air, pars si tu le veux
Traverse les sables et les eaux
Va où le vent te désire
La guitare s’inspire du battement de tes ailes
La mélodie pour le cœur
La voix pour l’espace
Et le mot libre au fond de moi.
Grandis encore
Même si tu n’en sais rien
La guitare t’accompagne
Te donne encore la main
Si tu le veux
Te laisser partir.