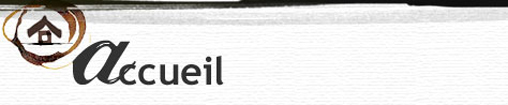Jules et Romain étaient heureux de se retrouver une fois de plus, dans l’île cet été-là et fiers de leurs débuts de jeunes collégiens. Elisa, à l’aube d’une adolescence qui épargnait encore les garçons, sentait mille feux en elle.
En toile de fond, les parents, présents mais trop pris par des problèmes intimes – crise de la quarantaine, miroir mon beau miroir… – pour prêter attention à cette petite bande de désœuvrés à soif d’aventures et d’émotions fortes. L’attention générale s’était relâchée. Le père de Jules était reparti travailler, disaient certains, rejoindre sa maîtresse, disaient d’autres. La mère d’Elisa restait prostrée dans sa chambre et ne sortait que pour acheter des cigarettes. Et les grands-parents étaient plus préoccupés par leurs rejetons que par leurs petits-enfants… On ne dira jamais assez que les vacances en famille favorisent la régression… et peut-être la boisson… ce sont les enfants qui trinquent !
Mais bon sang de bois nous étions dans une île, et ces gosses n’étaient pas aguerris aux dangers qui menacent les insulaires !
La première grosse connerie connue a été leur sortie secrète en mer, tous les trois, dans le petit voilier du père de Romain. Même si ça s’est bien terminé, on aurait pu leur parler à ces enfants, les rassurer peut-être, je ne sais pas… leur dire qu’on ne les aimait pas plus ou moins à l’aune de leurs exploits.
La deuxième connerie n’est pas connue de l’île et heureusement, les gamins ont failli détruire tous les parcs à huîtres du Port du Bec. Alors là basta ! Je suis sorti de ma réserve, je suis allé voir Jules, Romain et Elisa, je les ai traités de tous les noms mais c’est comme si j’avais pissé dans un violon ! Ce n’est pas moi qu’ils attendaient pour la sérénade.
On arrive à ce jour fatidique du 28 juillet. Le trio avait coutume de la prendre cette petite route qui relie la terre à l’île en quelques kilomètres, à marée basse. Même les automobilistes du coin savent qu’il faut aller vite, ne pas attendre le dernier moment, la panne sèche – un comble avec tant de flotte ! – vous fait vite regretter de n’avoir pas utilisé le détour par le pont de Noirmoutier. À vélo, les gamins faisaient des aller-retour sur la route – jeu stupide et dangereux – la mer commençait à tout recouvrir, pas à petites doses mais au galop comme la légitime qu’elle était ; les gamins l’ont défiée : « Allez, on tente encore un coup, on ira plus vite que la marée ! ». Ces jeunes fous ont oublié que sur l’eau dévalant à cette vitesse eh bien ! ça dérape les roues, qu’avec la peur, on perd les moyens qui restent. Ils ne voyaient plus que des flots tumultueux au puissant et destructeur courant. Ils se sont sentis perdus ; les deux garçons ne frimaient plus, les pleurs leur brouillaient la vue. Le salut est venu d’Elisa, la peur de la mort lui a réveillé la mémoire. Elle s’est souvenue des balises, a hurlé de lâcher dare-dare les vélos, de se précipiter sur la plus haute plate-forme, qui n’était pas loin de même que la patrouille de sapeurs-pompiers heureusement alertée par le père Mathieu qui avait vu le trio s’engager sur la route.
Le temps passe, les esprits se calment. Mais lors de la grande marée d’équinoxe en septembre, le village repense à ces mômes inconscients, à leurs parents davantage encore, et commente ; il n’épargne pas les grands-parents, pourtant natifs de l’île (ils l’ont quittée, cétacé pour déchoir).
Sûr que cela fournit du combustible pour tout l’hiver, le chauffage au ragot y’a pas mieux pour le fourneau !