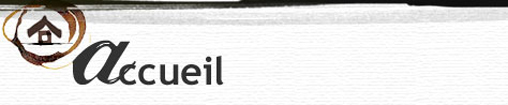Céline Durand
J’ai un arbre dans ma vie…
Je l’ai aimé tout de suite. Pouvait-on parler d’appartenance ? Il était là, rayonnant même sous ce ciel obscurci. Il dressait ses branches pourvoyeuses d’ombrage, des branches tendues jusqu’au ciel. Ses courbures, parfois noueuses, s’étendaient en apesanteur. Il flottait là, les feuilles dociles imbriquées en chevelure verte. Son tronc solide et granuleux portait son poids au-dessus du sol. Il était aérien. Étrange pour un arbre ancré au sol par ses nombreuses racines.
Je suis tombée amoureuse de ce chalet, de ce jardin, mais mon amour profond allait à cet arbre. Quand je l’ai vu, régnant sur le terrain, je l’ai trouvé si beau, fort, puissant. Mon regard convergeait en ses branches. Un toit, oui mais riche de son histoire. Il ne pliait pas le tronc, poussant vers la vie joyeux et insouciant. Je me promis de veiller sur lui. En réalité, c’est lui qui me portait de toute sa magie. Propriétaire j’étais, resterais et pourtant, quand le vent poussait ses feuilles, ses branches, le grincement du bois en parti couvert par le bruit des eaux du torrent me contait une autre histoire. La forêt en face de lui ne possédait pas le tendre de sa verdure. Il lui répondait dans les jeux de parfum, mais l’odeur suave de ses petites fleurs de tilleul ne se mêlait pas à la senteur forte des sapins. Je n’aurais pas aimé voir couler sa sève comme sur ces troncs écorchés et bordés de sciure. Il était à moi. Je touchais son tronc béatement comme s’il m’entendait et lui offrais la promesse de toujours le garder.
Et puis le temps passe, les événements s’entrechoquent. Lui, stoïque du lever au coucher du soleil, immobile et silencieux, perd de sa tendresse, dégarni d’une troublante calvitie, il hiberne. Le soleil et sa verdure me manquent. C’est l’hiver, la solitude. Il ne fait plus écran à l’œil des voisins. La saison passe. Le froid et maintenant le chaud, toutes ces images, toutes mes visions semblent animer ses feuilles. Elles s’orientent bizarrement et, de ma chambre, couchée au sol, mes yeux se portent dans les feuillages. Ses branches basses frottent et crissent sur le bois sombre du chalet. Tout se déforme. Je vois des personnages, là, dans leur parure folklorique et des casques militaires…Les sourires grincheux et cyniques obscurcissent ma vision et dansent au rythme éclairé de la nuit. La lune haute me gâche le sommeil et mon imaginaire galope de toutes ces histoires sordides, lues, racontées qui avancent dans ma vie comme un mirage. Le tilleul perd de sa volonté à me tenir paisible. Dessein unique d’une femme à vouloir posséder un cœur qui bat dans les ramages, une terre que l’on croit protectrice. Plus rien ne me protège… l’ennemi a passé ma porte. Le tilleul danse dans la nuit, dirigeant son canon, et son fusil est chargé.
Je me penche, touche son écorce et caresse le bois dont mes souvenirs avaient tu le crin rugueux, immobile comme un cheval de Troie. Je te haïs mais je t’aime surtout au-delà des mots. Habile de sensations, pourvoyeur électrique, je sens battre ton pouls et je me livre corps et âme à ta magie. Opérante, inopérante, tout s’alterne, tout dépend comment je te regarde. Je mets les yeux de biais et je vois ton profils biaiseur. Je te le rends. Les yeux ouverts, on se regarde de travers, ami, ennemi…Et puis je ferme les yeux. Alors là, je ramollis. Ton vice aux racines chargées m’emmêle à ta coupe. Je te scierai le tronc plus tard, je ne veux pas vivre dans ton odeur de sève récurrente et salissante.
Je souhaite beaucoup de bien à mon tilleul qui n’a jamais été à moi, qui n’a jamais été de bois. Sensation perfide, passagère et qui aujourd’hui indélébile, m’éloigne d’un tronc solide. Les feuilles mortes du tilleul ont encore changé de saisons. Arrondies, généreuses, offrant l’ombre de toute la force de leurs nouvelles pousses, elles tombent pour un hiver qui paraît toujours durer, même sous l’hécatombe d’un été. Tilleul, tu es passé de la magie au désenchantement. Mes larmes se sont taries et pourtant ton écorce solide ne semble pas en avoir gardé de traces. Tu vis, tu pousses, tu parles aux tiens, aux sapins élancés qui s’agitent en tout sens comme des mains qui se tendent pour se dire adieu. À eux tu parles. Tu parles au chat qui s’accroche tout en haut. Tu parles aux herbes folles. Mais moi, je n’entends pas ta voix. J’ai beau poser ma joue contre ton écorce agressive, je ne sens qu’une peau morte, invalide de guerre. La senteur de tes feuilles se noie dans l’odeur de tabac. D’ailleurs, je ne te respire plus, je ne te regarde plus. Tu n’es qu’une pièce dans un trop grand puzzle.
Tu m’as pris la main de ta branche noueuse pour me donner à ceux qui parlent ton langage. Muet. Tu es le pro du dialogue. La pie jacassante et le geai teigneux acculés à tes branches ont fait fuir l’écureuil. Oublieux de la balançoire accrochée à ta branche la plus sensible, tu as éradiqué le seul souffle que j’aurai pu pousser pour être enfin vivante. Opiniâtre, je me débats d’une réalité qui m’échappe. Prompte à me farder et à me décharger, j’accuse l’arbre de ses fresques et de ses farandoles, là sous l’écorce, là où ma main a palpé son cœur. Je me sens m’éloigner de lui et devenir autre. L’arbre a perdu de sa charge. Le temps passe encore. Il m’indiffère et ses branches taillées à vif ne m’intéressent plus… leur bois repose sous le hangar. Je l’exclus sans le brûler.
Le temps passe, les morsures restent. Ton tronc est lisse. Les pensées ne t’égarent pas. Tu pousses droit sous le soleil, tu pousses droit sous la lune. Oublieux et à la défausse tu t’acclimates. Je n’en prends plus ombrage. Tu es libre de vivre ta vie d’arbre. Tes racines profondes ont peut-être de l’envergure, même si la taille de ton ramage ressemble au plumage d’un paon faisant la roue avec ses mille yeux hypnotiques, ravageurs. Je succombe, renaît une dernière fois même si le son de ta voix ne coule que dans tes veines. Je ne peux t’en vouloir, tu n’es qu’un arbre.
La balançoire de l’enfant n’a plus sa place… moi non plus. Je dis adieu au tilleul. Je dis adieu à ce lieu dans lequel la beauté se transplante plus loin, dans le béton des villes, dans les magasins, dans les centres commerciaux.
J’ai eu un arbre dans ma vie…