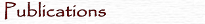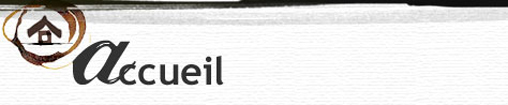Philippe LELEU
Un gars en costume cravate se plante devant lui. Henri, étalé de tout son long sur le carton qui lui sert de maison, considère deux souliers noirs, impeccables, lustrés de frais. La tête appuyée sur son avant-bras, il imagine que les chaussures vont lui délivrer un message. Comme elles restent muettes, il pivote lentement le visage vers le haut et découvre, juché sur un costume trois pièces, une tête chauve qui affiche une moue de dégoût. Elle éructe pour l’heure, des mots souillés de salive.
Vous me répugniez, Monsieur, vous sentez mauvais, fichez le camp de ce quartier, allez cacher votre misère ailleurs, c’est un quartier respectable ici !
Henri répond posément.
T’as entièrement raison, mon pote.
Bien sûr, il ne bouge pas d’un pouce. Le costumé détale comme s’il venait de lancer une grenade dégoupillée. Henri ne le regarde même pas s’éloigner et farfouille dans le tas d’objets hétéroclites, amoncelés au bout du carton, à la recherche d’un sac en kraft. C’est d’abord le froissement du papier qui le renseigne sur sa localisation. Il attrape le col du Kil de rouge qui dépasse du sachet marron et s’envoie une longue rasade derrière la cravate. Après une apnée glougloutante de huit secondes, ce qui au regard du délabrement de ses poumons constitue un record olympique, il produit un expire libérateur suivi d’un rot tonitruant et éclate d’un rire gras qui se transforme en toux bronchiteuse. Il poursuit un échange imaginaire avec le cravaté.
T’as raison, mon pote, ça pue ici. En plus de mon calbar qui n’a pas aperçu de robinet depuis des mois, j’ai établi mes quartiers dans la plus vaste pissotière à chat de la ville. Et oui, je suis répugnant mais il faudrait me payer cher pour prendre ta place, gros tas de merde. Moi, je suis en osmose avec ce parking. L’aération est au top, la dalle lépreuse du plafond ne suinte qu’en cas de gros orage et le loyer est abordable. Allez, à ta santé !
Tel Soyouz s’arrimant à l’ISS, le goulot opère sa jonction avec une bouche enfouie dans des poils parsemés de déchets alimentaires. Henri désarrime et considère la bouteille vide.
Ce coup-là, y en a plus. Il va falloir organiser une expédition de réapprovisionnement pas plus tard que très bientôt. Car comme dit Momo, quand y a plus de rouge et ben… y a plus de rouge.
Henri parvient à se hisser accroupi, pose les mains sur les genoux et pousse jusqu’à redresser le buste puis la tête. Ça le fait marrer de penser que c’est avec cette lenteur là qu’il demandait à ses élèves d’exécuter ce mouvement au cours de yoga du lundi soir. C’était il y a un siècle. Il époussette soigneusement les loques qui lui servent de vêtements, un jean bleu qui vire au marron et sa veste en tweed déformée par les mauvais traitements, dernier vestige de sa vie d’avant. C’est que Monsieur sort. Monsieur sort, bien qu’il soit déjà dehors. Monsieur compte au moins sortir du parking pour aller faire la manche sur le respectable boulevard afin de reconstituer les stocks de carburant.
Voici le moment de traverser tout le parking dans sa longueur. Le ciel nuageux assombrit encore la pénombre du volume où somnolent quelques voitures.
Par habitude, il disperse du pied des sacs McDo, des canettes de Coca, des barquettes de frites graisseuses que le vent a rassemblées sous la volée de marches en béton qui conduisent à la gare routière.
En farfouillant ainsi du bout du pied, il lui semble, deux fois de suite, percevoir un tintement métallique. Ce n’est pas le son léger de l’aluminium des canettes, c’est plus lourd. Une pièce de un voire de deux euros serait providentiel et de bon augure pour la réussite de l’expédition. Ses genoux craquent lorsqu’il s’accroupit. Henri disperse les détritus avec les mains en proie à une excitation légère. Il y a bien longtemps qu’il n’a pas ressenti ça. La dernière fois, il était sur la plage de l’Espiguette avec Caroline et les deux filles. C’est si loin, tout ça. Voilà, c’est cet objet qui tintait. Une sorte d’anneau en acier inoxydable. Combien de fois il a manipulé cette pièce d’accastillage ? Il considère la manille à goupille vissée et la porte devant ses yeux. Elle brille dans la semi-obscurité du parking.
Il ferme les yeux. Il voit la mer, immense, l’air iodé lui caresse les joues. Il se voit en train de manœuvrer sur le pont du voilier, visser l’axe de la manille pour accrocher le foc. Il éclate en sanglot comme un gosse, bras ballants, la tête relâchée. Comme tout ça lui manque. Putain que ça fait du bien de pleurer !
Trois ans qu’il ne cherche plus comment sortir de cet enfer. La douleur a enseveli la notion même de porte de sortie. Depuis l’accident, il a condamné toutes les pièces de sa maison intérieure et survit dans la cave qui s’incarne dans ce parking lamentable.
Ce petit anneau de métal lui a suggéré l’emplacement d’une porte. C’est la pièce manquante du puzzle de son âme. La pièce qui patientait sous un tas d’ordures en guettant le jour où son emplacement serait libre débarrassé des scories de la souffrance. Il ouvre la main et la regarde encore.
Il a envie de remercier l’anse d’acier qui lui infuse la détermination à se remettre à la barre de sa vie. Il remercie aussi le cravaté qui malgré ou peut être à cause de sa morgue a donné la pichenette qui a remis la machine à vie en marche.
Henri se dirige vers le bar de l’univers ou le taulier l’a à la bonne. Il s’approche du zinc.
Ahmed, laisse-moi téléphoner, c’est important
Mais bien sur vieux, tiens
Il y a un numéro que Henry n’a pas oublié. C’est celui de Marco. On décroche.
Allo Marco, c’est Henri.
Écoute-moi s’il te plait.
Viens me chercher.
Je t’expliquerai.
Je veux reprendre la course au large.
Je t’attends.