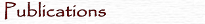Céline DURAND
Elle est rousse, un roux flamboyant, de longs cheveux écureuil, un front haut, un visage pâle criblé de taches de rousseur. Une petite fille comme moi. J’ai 6 ans, je ne la connais pas. Pas encore. Elle ne parle pas, me suit entre les arbres de la cour de récréation. Elle me gêne. J’essaye de m’écarter et pourtant cette couleur capillaire que l’on partage nous destine à nous rassembler. Nous unir. Je le sais, cette particularité rapproche. Prémices d’une amitié durable.
C’est une réunion de travail. Assis sur une chaise, il me tourne le dos. Une calvitie dans ses cheveux bruns mêlés, denses me dit dommage ! il est beau. Tiens, c’est donc lui Mômô.
Je joue aux cartes, un jeu d’Uno, avec les enfants du service. Il se mêle : encore lui, Mômô. Tout semble si facile dans ce lieu où les liens se créent où la beauté enneigée des sommets s’installe, de biais à travers les hautes baies.
Un petit bonnet de laine, des yeux bleus, quelques mèches de cheveux collées rassemblées sous la laine, mèches qui pourtant dépassent. Ma joie, mon enthousiasme, mon exaltation un bonheur immense, je n’ose la toucher. Ce soir, je quitte la Maternité, retrouve les fresques d’animaux peints au pochoir sur le plâtre blanc de sa chambre. Elle est née. Je l’aime déjà immensément. Nuit blanche.
Des hommes de Laurent Mauvignier, je ferme le livre, transie, oublie que ce livre n’est qu’une fiction qui a peut-être existé mais pas comme ça, non, pas comme ça. Trop de sang, trop de haine, trop de sadisme, trop cruel, une œuvre écrite de main de maître, un frisson de terreur et de dégoût complique mes peurs. L’armée française est impardonnable. Je la pensais propre, accusant le FLN de tout l’art de sa cruauté. Ça redonne la donne.
Dans le jardin, mes mains de petite fille attrapent l’oisillon dans son nid. Il piaille déjà ouvrant grand le bec. Il réclame, le pauvre. Je le gave de pain trempé dans du lait, y ajoute du jaune d’œuf. Avant la nuit, ses petits yeux luttent, se ferment, paupières lourdes qui tombent, corps qui sursaute encore vivant d’une dernière pulsion de vie puis raide, encore tiède. Sa mère l’appelle sans cesse, tourne, cherche. L’oisillon est mort, je l’ai tué.
Sur le lourd bureau de bois, affiché, un carton destiné à être lu. La psychiatre me regarde avec ses yeux de bourriche. Mieux vaut être suivi par un médecin que par plusieurs.
Aux Urgences psychiatriques, contre le mur un panneau d’affichage blanc où l’on écrit au feutre. Des mots inscrits, monde virtuel. Je ris sans savoir.
Une odeur forte, répugnante, je le dis à ma sœur d’une voix ferme, sans gêne, presque hilare. L’homme dans son fauteuil roulant, amputé, balade ses escarres. Je le fuis l’âme sourde, je ne l’oublierai pas, lui avec ses moignons roses, son odeur de pourri qui donne envie de vomir, qui indispose et qui pourtant ne soulève en moi qu’un agacement sourd, un rire, une colère.
Tu vas de la porte intérieure, du box fermé à la grille d’en face, t’y frottes, tu es sur tous les fronts, espères une caresse, une attention. Tes yeux bruns, doux, ton pelage sombre et tiède que mes doigts perçoivent à travers les barreaux. Tu me lèches. Je t’aime déjà. Viens, je t’emmène. Tu t’appelleras Gaïa. La Terre, la vie.
Je demande de l’eau. Mes membres sont attachés, on me libère une main. Le verre est posé sur le lavabo blanc, inatteignable, cette tête indifférente et cette voix qui pousse à la colère, provoque, une voix qui cherche querelle, une voix d’homme fort de son pouvoir, une voix qui fâche. Cette voix a répondu à mon insolite demande Non, je ne suis pas de la SPA. une voix. Il n’a pas de visage, il n’en aura jamais.
Je colle les images et les textes d’appui sur mon cahier. La professeur de chimie dit Regardez-moi celle-là. Elle fera femme de ménage. Une profonde humiliation me fait baisser la tête, je rougis. Sans rien dire, je me recroqueville et encore une fois, je me laisse définir. J’ai douze ans.