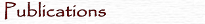Paule GAILLARD
Bérengère,
Comme convenu, voici le compte-rendu de mon expédition sur site.
Après des heures de bus surchauffés depuis les bords de la Méditerranée, nous sommes arrivés dans une contrée désolée faite de cailloux noircis au soleil avec de rares touffes d’herbes rases et sèches. Aux alentours, à perte de vue, rien. Que le soleil.
Le bus s’arrête.
Le conducteur se tourne vers moi et me dit : « C’est là ».
Je ne suis pas trop étonné parce que d’autres passagers auparavant, à d’autres arrêts, sont partis aussi vers rien. L’air confiant.
Ma confiance se loge dans ma boussole. Je dois me diriger vers le sud-ouest. Donc je marche, sud-ouest, vêtu de mon long burnous en poils de chameau qui repousse la chaleur et d’un chèche sur la tête. Une outre en peau de chèvre odorante pleine d’eau et des dattes dans les poches, je marche.
Un silence, infini, obsédant, m’environne. Juste le bruit de mes pas et de ma respiration.
Flotte dans l’atmosphère une odeur métallique.
Je marche longtemps. Longtemps. Toujours sud-ouest. Nos informateurs ont bien insisté : bien garder le cap.
L’horizon de cailloux à 360° est toujours vide.
Tout au long de cette piste quelques dattes et un peu d’eau font passer le temps et la fatigue. Encore quelques gorgées d’eau et mon outre sera vide.
Soudain m’apparait le miroitement d’un lac avec en surplomb des structures verticales paraissant flotter. Des effluves de Ras-el-hanout me frappent en plein nez, ce mélange d’épices propre à l’Afrique du Nord. Assurément j’hallucine.
Je repousse le lac au fur et à mesure de ma progression. Bien sûr c’était un mirage. J’avance, sud-ouest, j’approche. J’ai faim. J’ai soif. Bientôt le lac disparaît tout à fait, ne restent que les structures verticales et le silence. Pas âme qui vive. Le lieu sent l’abandon. Aurais-je fait tout ce chemin pour rien ?
Les structures s’avèrent être des vestiges disparus de Paris, capitale de la France. Je circule entre des verrières art-déco d’entrées de métro, des fontaines Wallace, deux pavillons Baltard. Le silence n’est rompu que par le ruissellement de l’eau des fontaines qui semblent miraculeuses au milieu de ce désert.
Toujours personne. J’avance encore, le regard à l’affut.
Soudain, plus loin dans un creux, une oasis verdoyante émerge. Des palmiers, un immense champ de blé en herbe. J’entends des chameaux qui blatèrent et des hennissements, quelque part.
La nuit tombe. Presque d’un coup comme toujours sous cette latitude.
Soudain des torches m’environnent, une forêt de torches tenues par des mains velues. A leur lueur je distingue des êtres qui semblent issus d’un film de science-fiction. Les plus grands doivent mesurer 1m50 mais la taille moyenne est aux alentours de 1 mètre. Avec mon mètre quatre-vingts je suis un presque géant. Aucune animosité à mon endroit.
Une foule immense m’environne, m’entraîne, me porte vers une entrée de métro. Nous descendons une rampe de pierres plates et nous nous retrouvons dans un énorme espace circulaire creusé de main d’homme sous le roc. Des rampes lumineuses au plafond éclairent la salle. Ce que j’ai pris pour des torches n’en sont pas. Ce sont des systèmes électriques ou gazeux que je n’ai jamais vus auparavant.
Mes guides entre eux parlent un langage que je ne comprends pas, une sorte de bruissement mêlé de chuintements. Leur corps est celui d’un homme couvert de poils ras noirs. Quant au visage… c’est un peu celui de Nénette la brebis que mes parents avaient élevée et que nous avions fini par manger. Je remarque que chacun d’eux a une courte antenne noire et verticale derrière l’oreille gauche.
Au fond de la salle, dans une loge semi-circulaire, sur une sorte de trône taillé dans la pierre, assis, un homme m’attend.
C’est Jean Castex.
D’un geste il m’invite à prendre place devant lui sur une sorte de gros pouf. A mes côtés sur un plateau on dépose une cruche d’eau et une écuelle d’olives noires. Je bois longuement. Je mange quelques olives.
Le peuple de mutants s’est assis à même le sol tout autour de moi face à ce qui semble être le maître.
Jean Castex s’exprime.
Je te résume.
Depuis le Covid il a beaucoup travaillé avec les laboratoires Siberta. Ils ont fait des expériences. Le résultat est autour de moi. Des zombiômes. Contraction de zombie et d’homme. Une fabrication de travailleurs disciplinés et radieux, corvéables à merci. Ces êtres sont issus d’un croisement entre l’homme et une race de mouton très ancienne et résistante dont l’origine remonterait à l’époque de la Reine de Saba.
Cette oasis abrite des laboratoires de recherches sur l’ADN et le génome. Une vraie réussite.
Chaque entrée de métro conduit à un laboratoire dissimulé. Les pavillons Baltard abritent des serres de légumes et de fruits. Les zombiômes sont végétariens. L’électricité est produite en souterrains par des cohortes de zombiômes-pédaleurs renouvelables à l’infini. Ils pédalent inlassablement au-dessus de puits reliés à des cavités au centre de la terre d’où on extrait un gaz inconnu jusqu’à il y a peu dénommé : le cycloprompt.
Des recherches sont toujours en cours pour imaginer un nouveau virus 100 % mortel cette fois qui éradiquera cette misérable race d’humains jamais contents, onéreux, toujours en grève au profit de ces mutants apaisés.
C’est ce qu’on appelle « Le grand remplacement ».