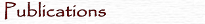Ana SURRET
Buffet de la gare
Caroline consulte sa montre : 19h50, son train part à 21h25. Elle laisse échapper un grand soupir d’aise, elle va enfin pouvoir se poser, s’accorder un peu de répit, ne plus penser au boulot et se mettre en condition pour apprécier ce énième voyage en train.
D’un pas décidé, traînant sa valise, elle s’approche de la gare qu’elle ne connaît pas.
Une grande curiosité l’anime. La pluie incessante jusqu’en fin d’après–midi a nimbé toutes choses d’une humidité tenace et elle ne distingue rien du décor du buffet à travers la buée qui adoucit juste un peu l’éclairage du lieu.
Elle doit pousser fort la porte retenue par un bloom puissant, pour que la porte s’ouvre enfin. Un mélange d’odeurs caractéristiques l’assaille. Au moins elle n’est pas dépaysée. Elle reconnaît celle des frites, de la choucroute et plus subtil, le relent du vin finissant de sécher au fonds des verres qui attendent sur les tables et le comptoir avant d’être lavés. C’est toujours comme ça après les repas du midi et du soir. Pour celui du midi il y a en plus l’arôme du café qui plane, s’évanouit pour mieux revenir l’envelopper lorsqu’on lui amène sa tasse. Elle peut classer les gares selon la qualité du café. Elle dit même qu’elle ne veut plus mettre les pieds dans certaines gares tant le café qu’elle a bu au comptoir de leur buffet est mauvais.
Derrière elle la porte se referme dans un grand déplacement d’air.
Ses lunettes sont embuées. Juste un instant elle s’amuse de cette vision filtrée comme à travers du verre dépoli. Elle ôte ses lunettes pour mieux embrasser le décor où elle va attendre son train en se restaurant.
Elle avise une table ronde le long du mur, en face du bar. Deux chaises sont placées de part et d’autre. Sur l’une elle pose son manteau, son sac et la sacoche de l’ordinateur, elle s’assied sur l’autre et tire sa valise entre les deux.
Une cimaise court le long du mur, au–dessus trois miroirs disposés à égale distance les uns des autres renvoient en trois exemplaires presque identiques, l’image de la salle qui n’est pas très grande. Caroline compte la présence de moins de trois douzaines de tables, la plupart de même taille que celle qu’elle a choisie, c’est–à–dire que l’on y tient à trois ou quatre personnes autour et encore en se serrant bien et pour ne prendre qu’une boisson.
Deux tables rectangulaires parallèles au mur de la porte par où elle est arrivée sont là pour les familles, les groupes de copains en partance pour un matche de l’AC Milan ou un départ en vacances. D’un coté une banquette en simili cuir d’un rouge passé et de l’autre des chaises, du même modèle que celle où elle a posé son céans, encadrent ces tables dignes d’un réfectoire.
Le bar en demi cercle est dupliqué par les miroirs qui multiplient les verres, les bouteilles, la fontaine à bière et le percolateur. Derrière le zinc, car le plateau est en zinc, vestige d’une époque où le formica n’avait pas encore détrôné les matériaux d’antan, un homme, cinquante ans, peut–être moins, les cheveux déjà rares et coupés courts, s’affaire à servir quelques clients paraissant seuls au monde.
Quel con, il a failli me faire rater le train
Porte 18, la voilà. Houa ! ça s’modernise à la SNCF, ils parfument les cabines !
Quel empoté, pouvait pas fermer sa valise comme il faut, j’ai failli tomber en marchant sur sa bombe de mousse à raser.
Me v’là tranquille pour au moins trois paires d’heures.
– Le wagon bar s’il vous plaît ?
– Voiture 12 Madame, de ce côté–ci
Il est bien aimable celui–là, pas comme le contrôleur hier soir.
– Je vous remercie Monsieur, bonne journée.
– A vous aussi Madame et bon séjour en Italie.
Ah, ces Italiens, dès qu’ils abordent une femme, ils draguent !
Aïe, c’est bondé.
– Pardon, pardon.
Un tabouret libre.
– Un thé au lait et deux croissants s’il vous plaît.
J’ai une faim de loup.
– Si Signorina.
– Bonjour, seriez–vous une compatriote ? Je suis de Dijon et vous ?
– Bonjour.
Plutôt directe celui–là.
– Je suis Française en effet.
Pas mal, pas mal, un peu bedonnant quand même.
– Je me présente, je m’appelle Gérard Richmont, je suis commercial dans les machines outils. Je vais à la foire de Milan où nous avons un stand. Vous aussi, vous allez à la foire ?
– Désolée, je ne vais pas à la foire.
Vite mon plus beau sourire de princesse dédaigneuse.
– Dommage, nous aurions pu nous croiser et boire un café ensemble.
– Oui, dommage en effet.
Quelle hypocrite je suis !
– Je n’aime pas être seul à l’étranger et le collègue qui devait m’accompagner s’est cassé la jambe au ski.
– C’est regrettable pour lui et je suis sûre que vous trouverez d’autres français à la foire, elle est très prisée des entreprises hexagonales.
– Vous avez raison. C’est que… je ne parle presque pas italien… Enfin, je verrai bien.
– Je vous souhaite une bonne réussite dans vos affaires. Au revoir Monsieur.
Plutôt collant celui–là
– Maguy !
– Caroline !
– Toi ici ?
– Si j’m’attendais à te trouver là.
– Et moi donc.
– T’as dormi dans l’train ?
– Evidemment, et toi ?
– J’suis à la 18 et toi ?
– A la 14.
– Tu vas à la foire de Milan, comme le grand benêt bedonnant qui m’a fait du gring au bar.
– Non, je vais voir ma tante Elisa, tu sais la sœur de ma mère. Et toi que vas–tu faire à Milan ?
– Je vais présenter à des investisseurs, un gros projet immobilier sur la cote basque.
– Ben mazette, tu vas devoir leur en mettre plein la vue car les Italiens sont plutôt retors en affaires.
– Je sais. Surtout que le boss qui devait venir avec moi, ne sera pas là, il a été contraint de rester à Paris. Tu imagines si je flippe.
– T’en fais pas, je connais ton talent, je suis sûre que tu sauras vendre ce projet.
– On fait notre valise en vitesse et on se retrouve au bar.
Le café fume dans les tasses.
– Maguy, tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait de te voir.
– C’est réciproque et je regrette de ne pas t’avoir dit dans mon dernier courriel que je projetais d’aller en Italie. Nous aurions pu coordonner notre emploi du temps pour faire des choses ensembles.
– Tout n’est pas perdu, je ne rentre que dimanche. Mon rendez–vous avec les Italiens est aujourd’hui en fin d’après–midi. Avant je voulais faire les magasins. Demain je serai au salon de l’immobilier de montagne pour glaner des idées intéressantes sur le plan architectural et en ce qui concerne les aménagements intérieurs. Et samedi, je n’ai rien de prévu.
– C’est super, nous pourrons nous voir samedi. Je peux même te servir de guide pour une visite privée et insolite de Milan. Je te ferai découvrir plein de choses amusantes.
– D’accord, mais pour la tenue, ce sera jeans, baskets et doudoune, comme lorsque nous étions étudiantes, histoire d’oublier le boulot.
– Et nous draguerons les garçons, puis les laisserons plantés là !
Le tunnel
Zut, manquait plus qu’ça.
Où sont les boutons ?
Les v’là. Chauffage, non lumière.
Mais ça marche pas. Juste dans ce foutu tunnel qui n’en finit pas.
Qu’est–ce que j’ai fait tomber ?
Mon téléphone s’éteint. J’suis nulle, j’ai oublié de le recharger hier.
Qu’est–ce qu’ils foutent à coté ? Y s’battent ou ils se cognent partout.
À tâtons, je recense les objets autour de moi, trouve mon sac qu’une secousse plus forte que les autres met à terre avant de l’avoir empoigné. Aux bruits, je sais qu’il s’est renversé : cliquetis des clefs, son plus feutré des stylos et roulement doux dans la cadence du train de la mini bombe de laque. Le roulement s’arrête, la bombe a du se coincer quelque part. En déplaçant mon pied droit, je rencontre une bosse. Ma main suit ma jambe, frôle ma cheville et s’arrête sur mon portefeuille échappé lui aussi de mon sac.
Avec ma main gauche, je balaye le vide de plus en plus bas, jusqu’à tapoter le sol du bout des doigts. Deux stylos, mon poudrier, des feuillets que je mets un moment à identifier – sans eux je ne pourrai justifier la réservation de ma chambre d’hôtel, c’est un sésame ô combien précieux en cette période d’affluence de visiteurs à Milan.
J’ai l’impression de participer à une chasse aux trésors. Je sens ma bouche s’étirer dans un sourire et mes yeux se plisser de plaisir et me mets à genoux. Me revoilà toute petite fille, pas encore sûre de ses jambes, partant à l’exploration de l’univers des grands et mes parents riant de me voir me déplacer aussi vite sur les genoux.
Aïe ! Fais attention ma belle, cette cabine n’est pas ton salon. Tiens voilà ma laque et mon sac ! Ma main droite reconnaît la douceur de l’agneau de ma besace.
Je me redresse, un cahot m’envoie m’asseoir au fond de la banquette, tandis qu’un long grincement vrillant mes oreilles accompagne un ralentissement prononcé. Le train va si doucement que je peux compter le raccordement des rails. De mon exploration à ras le sol, je garde une odeur de poussière chaude dans le nez. C’est la même que dans mes souvenirs de voyage, l’hiver, pour aller chez ma grand–mère.
Finit quand ce tunnel ?
- C’est où les toilettes ?
Sont fous ceux–là de se déplacer dans le noir ! Et comment vont–ils faire une fois aux toilettes ? Vont mettre la main dans la cuvette pour savoir si c’est pas le lavabo ?
- Y–a quelqu’un ? dit une voix par l’entrebâillement de la porte
- Oui !
Je claque la porte et mets le loquet. Une onde de chaleur et quelques frissons parcourent mon dos et mes mains deviennent de glace.
J’ai soif, mais je n’ose bouger. Dans le couloir, des frôlements de vêtements, des échanges à voix basse. Des talons frappent le sol dans le staccato lent du train, j’imagine une silhouette lourde se balançant du coté fenêtre puis du coté des cabines. Je perçois des voix mêlées venues de loin.
Et le train avance toujours avec la même lenteur.
J’aimerais mettre en parallèle son « tacata » avec le tic–tac d’une horloge et pourquoi pas aussi, calculer sa vitesse actuelle. Ouais, mais je ne connais pas la longueur des rails. Est–elle égale pour tous les morceaux ? Ça ressemble aux problèmes d’autrefois.
L’odeur de la poussière chaude n’est plus seule. Un doux parfum – que je connais bien puisque c’est le mien – arrive à mes narines. Y’aura plus besoin de désodorisant dans cette cabine, mais il y a à parier que je vais devoir trouver une parfumerie.
Quelle heure est–il ? Pourquoi je n’ai pas pris mon autre montre ?
La tête penchée vers la fenêtre, je scrute le noir uniforme. Il n’a pas une zébrure, on dirait même qu’il n’y a plus de vitre, le noir du dedans est égal à celui du dehors. Ou c’est le noir du dehors qui a envahi le dedans.
Debout, je plaque mes mains sur la vitre. Elle est froide et vibre sur toute sa largeur, sur toute sa hauteur. C’est ce que mes mains ont découvert en parcourant sa géographie.
J’écarte les doigts en éventail et laisse couler en moi les vibrations régulières. Elles rejoignent celles captées par mes pieds, je me sens en harmonie avec le train. Je me fonds dans le noir et j’accompagne le bruit du train d’une mélopée muette. Une lueur rouge balaie la vitre de droite à gauche à hauteur de mes mains. Tout aussi furtivement, une masse noire disparaît entre les doigts de ma main gauche. C’est la fin du tunnel.
Dans un noir ponctué de masses encore plus noires, des points lumineux se déplacent. Le train a repris de la vitesse. Je n’arrive plus à suivre son rythme. Je me rassois et j’attends, à l’écoute des bruits du wagon.
La fin du voyage
La lumière revenue, Caroline se rend au bar, elle a soif.
Tout en marchant elle se laisse distraire par le déséquilibre né du cahotement régulier du train et manque rentrer dans l’homme sorti juste devant elle, de la dernière cabine du wagon.
– Oh ! Pardon, j’vous avais pas vu.
– C’est moi qui m’excuse, je n’aurais pas dû sortir ainsi sans regarder.
Caroline a l’impression d’être passée au scanner par les yeux posés sur elle. Elle sent la chaleur lui monter aux joues.
Je vais au bar lui dit l’homme, je n’en peux plus de l’immobilité.
Elle s’entend répondre : moi aussi je vais au bar, faisons le chemin ensemble.
Il acquiesce d’un sourire et en trois enjambées il est déjà à la porte vitrée de l’autre wagon et se retourne.
– Alors, vous venez !
En courant elle le rejoint et reste dans ses pas, presqu’à le toucher. Il choisit une table et lui fait signe de s’asseoir face à lui.
Elle ose le regarder.
A sa taille – il la dépasse d’une tête – s’ajoute une élégance naturelle. Comme elle, il porte des lunettes. La rondeur des verres cerclés de fer lui donne une allure juvénile ; impression contredite par les mains solides qu’il a posées à plat sur la table.
Il commande deux cafés qu’ils boivent en silence en se regardant. Elle se perd dans l’iris presque aussi sombre que les cheveux bouclés de l’homme.
Il règle la note, lui prend la main et l’entraîne derrière lui. Elle se sent légère, une onde chaude monte dans ses entrailles.
Ils se plaquent côte à côte contre la vitre pour laisser passe un groupe. Le couloir vide, l’homme se tourne et pose sa main sur sa nuque. Une décharge électrique agace son épine dorsale.
Arrivés devant sa cabine, il la plaque contre la porte, fait écran de tout son corps et l’embrasse derrière l’oreille. Dans son dos sa main cherche la poignée, la porte s’ouvre, elle ne résiste pas, se laisse aller la bouche entrouverte, les yeux fermés. Une odeur de parfum d’homme, le bruit du loquet, quatre mains avides, deux corps enfiévrés, deux bouches ogresses…
Caroline est sagement assise sur le bord de la couchette de sa cabine et son stylo court à toute vitesse sur la feuille déjà emplie à demi de son écriture fine et serrée.
À Caroline
C’est incroyable ce qui m’arrive. Est–ce ça, que l’on appelle le coup de foudre ?
Il y a deux heures je ne savais même pas l’existence de ce garçon…
En relisant le début de la lettre, elle serre fort la carte de visite qu’il lui a donnée, au dos de laquelle il a écrit « je t’aime, marions–nous ».
C’est fou ça, raisonne ma fille. Bon, nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre, un moment de folie, d’égarement.
Demain j’irai faire le test du Sida, on ne sait jamais.
Pourquoi ai–je perdu la tête ?
C’est peut–être lui que j’attendais depuis si longtemps.
Rappelle–toi, il y a huit jours, tu disais à Virginie qui te proposait son ami Julien comme chevalier servant, que ton chevalier surgirait comme ça, de nulle part. Sans y croire évidemment.
Que vas–tu faire maintenant ? Il y a trente minutes il est descendu du train parce qu’il était arrivé à destination et il y a déjà un grand vide à coté de toi.
Réagis ma fille, oublie, ce n’était qu’un instant, une rencontre météore qui ne se reproduira plus jamais.
Contemplant les quelques mots qu’il a écrits, elle poursuit.
J’ai l’impression que ce sont des lettres de feu, je sens leur chaleur et j’ai encore sa voix dans l’oreille.
Zut, t’es complètement barjot, une histoire dans un train, ça peut pas avoir de suite.
Elle signe d’un paraphe rageur, arrache la feuille du bloc, attrape une enveloppe dans la sacoche de son ordinateur et libelle dessus son adresse à elle, avec application. Elle la postera tout à l’heure à l’arrivée en gare de Milan.
Elle ne veut pas savoir pourquoi elle fait ça.
Elle boucle ses bagages.
Dans le miroir du cabinet de toilette, elle contemple sa mine défraîchie, noircit ses cils, met du rouge sur ses joues, un joli rose sur ses lèvres, les pinces pour égaliser la couleur, chausse ses lunettes derrières lesquelles ses yeux brillent d’une larme retenue.
Une voix mécanique annonce l’entrée en gare. Elle enfile son manteau, jette un dernier coup d’œil pour s’assurer de ne rien oublier, agrippe ses bagages et sort dans le couloir.
Il y a déjà du monde se pressant pour descendre. Elle opte pour la porte sur sa droite, elle ne veut pas passer devant la cabine de l’autre bout du wagon. Elle suit le flot des voyageurs, se retrouve sur le quai, repère la sortie, avance et franchit les lourdes portes de la gare.
Du haut du parvis, les oreilles vrillées par la cacophonie des klaxons, elle contemple les vieux immeubles dominant l’habituelle et inextricable mêlée de voitures.