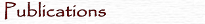Claude VUARCHEX
A cause de la couleur rouge des persiennes, de la couleur rouge des ferrures. Odeur pénétrante de peinture. Dans le feuillage des platanes, des moineaux se chipotent. En salopette bleue, béret noir vissé sur la tête, d’un va et vient rapide et précis, Auguste redonne une jeunesse aux volets. Lèvres pincées par moments, menton légèrement relevé, regard s’insinuant au-dessous de ses doubles foyers, pinceau tenu en porte-plume, il applique une deuxième couche de Valentine. Derrière lui, la grande allée qui s’étire jusqu’au haut portail vert à claire-voie. Rouges, les dahlias et bégonias qui alternent avec muguet et rosiers aux fragrances variées sous la rigoureuse mais bienveillante autorité des buis. Buis que la grande cisaille chaque année taille à coups secs au carré.
La grande allée où inlassablement, un garçonnet tente avec naïveté de courir plus vite que son aîné de six ans. Où ce même gamin, chevilles écorchées, mollets maculés de cambouis après moult échecs, parvient en zigzaguant à pédaler plus de dix mètres sur la vieille bicyclette paternelle.
La grande allée longée par un talus verdoyant à l’opposé des buis, où dominent deux arbres imposants : un poirier et un cerisier. Rouges, les boules qui illuminent ce dernier, rouges offrandes craquantes sous la dent pour humecter le palais de leur chair sucrée. Chaque année, le cerisier héberge une haute échelle où juché à la cime, Auguste emplit son panier. Rouge, son contenu. Rouges, les lèvres du môme qui virevolte parmi les branches basses. Rouges aussi les taches sur sa chemise.
Le haut du talus est prolongé par un coteau verdoyant pourvoyeur de luzerne fraîche ou de foin odorant pour les lapins. Swatch… swatch… ressasse la faux dans un mouvement d’un tiers de cercle, animée par les mains d’Auguste qui descend pas à pas dans la pente. Arc-bouté, il laisse aller devant lui la fine et longue lame en liberté surveillée. Bras gauche replié, l’autre tendu, dans une rotation du bassin, son corps se vrille puis se délie sans forcer dans un mouvement facile, huilé, inexorable. Twiiing tann, twiiing tann reprend de temps à autre la pierre à aiguiser. D’un aller-retour bref et autoritaire, le long de l’acier tenu près du corps, elle redonne à la lame une vigueur nouvelle. Pierre à aiguiser replongée entre chaque action dans le coffin, corne de vache accrochée à la ceinture du faucheur. La luzerne pour produire un bon foin doit être retournée en maniant la fourche avec précaution pour éviter de dépouiller les tiges des feuilles sèches, le chaud soleil se charge du reste.
Rouges, à saisir avec délicatesse, les perles accrochées en menues grappes aux groseillers non loin d’ici.
Rouge-carmin, les fragiles framboises que l’on cueille sans les meurtrir, qui fondent sur la langue.
L’Angélus sonne au clocher tout proche, signal pour ramasser les outils épars, la veste, signal pour rentrer. Tout le monde ne rentre pas. Un gamin de sept ou huit ans gambade à la tombée de la nuit dans la luzerne malgré l’interdit de coucher l’herbe. Son jeu est de happer en plein vol les hannetons lourdauds aux pattes crochues qui gratouillent les mains, de les déposer dans une haute boîte en fer. Etrange concert de vrombissements de crissements, de crépitements métalliques, de craquotements, de pattes qui crabotent, s’accrochent, s’agrippent, se crispent, pattes crochues qui écrivent des messages secrets.
Rouge-vermillon, les fraises des bois à la saveur subtile et sucrée, petits bonbons en contrebas des buis -qui parfument les environs proches- dans la terre brune du potager. A quelques mètres encore, cette terre brune du potager que l’on retourne chaque année à la triandine. Terre brune, fraîche, d’où s’échappent des lombrics dodus, indignés d’être ainsi dérangés. La poussée du pied sur la bêche est ponctuée de lancers des pierres importunes. Elles se retrouvent en petits tas dans le fond du jardin contre le mur d’enceinte. On déroule le cordeau au printemps pour délimiter les diverses planches. Haricots, pois, carottes, aubergines, courgettes, tomates, et d’autres légumes encore. Haricots et petits pois que l’on ramasse, en temps voulu, les jambes écartées au-dessus de la rangée, échine courbée, fouillant le plant, prélevant ceux qui atteignent la maturité.
Haricots et petits pois que l’on retrouve avec Hélène dans la cour ombragée par les platanes sur le banc de bois. Haricots que l’on effile par brèves saccades répétitives. Petits pois que l’on écosse en glissant le pouce à l’intérieur de la gousse que l’on déboutonne sans égard après avoir tiré sur l’attache. Les grains débaroulent dans les casseroles dont on compare fièrement les contenus obtenus. Les gousses dépouillées feront le régal des lapins. Rouges, les tomates dont le chef de famille s’enorgueillit en pesant ou exhibant les plus beaux spécimens devant les voisins.
Pour un peu, j’oublie les patates… Dans le coteau, les patates ! Déjà pour les planter, le gamin est muni d’une baguette qui matérialise l’écart entre les plants. Courbé avec le père qui trace le sillon au bigot, le môme prélève dans un panier les pommes de terre coupées en morceaux porteurs d’un ou plusieurs germes. Il les dispose dans la raie aussitôt rebouchée par l’habile pioche à deux cornes. L’arrachage n’est pas plus reposant pour l’échine. Le bigot ne doit pas pénétrer le sol à l’esbrouffe mais se fier aux fanes et à l’écart laissé lors de la plantation sous peine de percer une patate plus ventrue que les autres. La longue colonne de pommes de terre ainsi exhumées sera ramassée dans des paniers vidés ensuite dans des sacs -sacs de petites différenciés des sacs des grosses- qui seront acheminés à dos d’homme -ou d’un gamin qui veut montrer ses forces juvéniles- jusqu’à la cave. Où, étalées, elles devront être dégermées pendant l’hiver. Certaines années, il faut surveiller les fanes et faire la chasse aux doryphores, legs des bateaux venus des Etats-Unis. Ces diables de bestioles laissent une teinte orangée dans les mains. Les poules en raffolent.
C’est une époque où tous les produits du jardin sont consommés -ou offerts aux voisins- frais ou en conserve. Hélène logeant les haricots dans les bocaux en verre, lesquels bocaux sont entassés, entourés de linges dans la grande lessiveuse d’eau mise à bouillir sur le gaz. Les haricots, tomates ne sont pas les seuls à être stérilisés, les fruits subissent le même sort. S’ensuivent les mises en garde rituelles au moment du lever de couvercle. Les bocaux Le Parfait -manquer ses conservations avec un nom pareil serait une faute- se présentent, enturbannés de tissus fumants, dans toute leur splendeur. Ils demandent toutefois quelques minutes de recueillement avant d’être manipulés avec délicatesse. Leur destination sera la cave jusqu’à la minute où ils réapparaîtront sur la table hivernale. Le chef de maison maintiendra fermement le Parfait élu, ouvrira la guignochette du couvercle, tirera sur la languette du caoutchouc orange, s’y reprendra parfois à plusieurs reprises, aura même peut-être recours à un coin de sa serviette. Sous le rouge de l’effort final, le pschhhh libérateur, accompagné du Aaaaaah de satisfaction générale, permettra de soulever le couvercle de verre cerclé de fer.
C’est une époque où jeter du pain serait un blasphème. Où l’opinel du chef de famille en début de repas, sort de la poche de poitrine de la salopette bleue, s’ouvre dans un clac de suffisance, découpe les tranches de pain. Incomplètement. Pour que chacun détache sa portion au moment où le pain lui est présenté. Où l’on ne commet jamais l’impair de quitter la table sans avoir fini son pain. Où l’on finit ce qui est dans son assiette, on « l’essuie » avec son pain avant de prendre « du » plat suivant. Où le pain, le repas terminé, regagne, plié dans un torchon le gros tiroir de la table. Où le pain trop rassis est humidifié et repasse au four. Où le pain en excès est réemployé avec quelques œufs en pain perdu. Une époque où à table les enfants ne s’avisent pas de couper la parole à un adulte.
C’est une époque où on allume la radio au moment du repas. Le fidèle poste de radio installé sur sa table dans l’angle de la cuisine. L’écran sur lequel on peut lire toutes les stations des grandes ondes, petites ondes et ondes courtes. Fenêtre surmontée du tissu ocre qui vibre parfois, animé par le haut-parleur qu’il protège. Son transformateur en bakélyte noire situé au-dessous voisinant avec le fil d’antenne déployé. On allume la radio pour les informations de Jean Grandmougin, et après La famille Duraton, juste avant le Radio crochet ou le Quitte ou double présentés par Marcel Fort ou le Vingt-et-Un de Zappy Max. Alors, c’est souvent la lutte pour le café. C’est à celui des enfants -petite bousculade, chamaillerie- qui s’empare du moulin. Le cale entre ses genoux, entrouvre le demi-cercle en fer pour loger les grains dans le réservoir et celui-ci à peine fermé, d’activer la manivelle comme un fou comme si la vibration du moulin en bois, le bruit des grains broyés était une récompense. Certains mercredis soir (pas d’école le jeudi) les enfants ayant droit à un coucher plus tardif, nous allons chez les voisins regarder La Piste aux étoiles à la télévision.
C’est une époque où peu de familles possèdent une voiture, où beaucoup prennent le train de 7h07 pour travailler à Saint-Fons ou Lyon. Une époque où la petite gare laisse échapper à 17h43 ou 19h22 un flot de « travailleurs » qui remontent la pente sac sur l’épaule ou sac à main chargé en longs défilés bruyants et animés. Une époque où les gens se rencontrent, prennent le temps de se parler. Une époque où les gens ne poursuivent pas leur ombre.