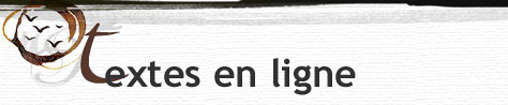Eliane Michalon
Extrait du journal d’Honorine Malland communarde déportée en Nouvelle Calédonie.
13 mai 1872 :
Le mauvais temps a disparu, nous voguons maintenant vers l’Afrique, je profite des promenades sur le pont, moment de liberté, et de solitude, d’oubli de la captivité pour respirer, m’enivrer, la brise marine soulève mes cheveux, rosit mes joues si pâles, j’ai jeté par-dessus bord mes bas troués, mes pieds nus foulent le bois dur de la passerelle, je commence à apprivoiser le roulis comme un vrai marin. Je marche le long du bastingage jusqu’au grand mât, comptant mes pas je reviens à l’avant de la goélette vers le mât de misaine. Quel parcours ! Il aura fallu cette défaite cruelle pour que je voyage, certes dans des conditions horribles, je suis prisonnière, mais la mer, la mer ! C’est la première fois que je vois la mer, cette immensité, j’en avais rêvé, maintenant je suis comblée, la mer m’entoure telle une robe de bal dont l’écume des vagues serait les volants de tulle blanc. Nul cavalier pour me faire danser, seuls des officiers en uniformes pour nous humilier, qu’importe ils ne peuvent m’empêcher de lever la tête vers le ciel, de suivre les nuages jusqu’à ce que la tête me vire comme lorsque je valsais dans les guinguettes du bord de Marne. Insouciance de la jeunesse, je me sentais légère malgré notre vie si rude. Les nuages filent, filent poussés par le vent. Qu’ils m’emportent avec eux vers cette terre lointaine et inconnue, qu’ils m’emportent sans mes chaines, que ce navire corset de bois qui m’étouffe se disloque et sombre dans ce gouffre d’eau sans fond. Ils ne peuvent m’empêcher de rêver à cette destination ignorée de moi, où le soleil brille toujours, les branches des arbres croulent sous les fruits multicolores, la végétation luxuriante incite à la paresse, les plages de sable blanc sont diamants où j’irai noyer mon corps, le bruissement du vent dans les feuilles des cocotiers. Un homme chante dans les huniers, mélodie nostalgique qui parle de son village, je m’arrête l’écoutant évoquer une fiancée au pays là-bas. La proue du navire trace un sillon dans l’eau verte, je reprends ma déambulation, au début je sentais la mer comme une présence hostile, peu à peu je l’ai apprivoisée mais il faut s’en méfier, son spectacle peut donner l’oubli de l’exil, un jour elle est calme et brisera tout le lendemain. Quand arriverons-nous ? Les habitants, comment vont-ils nous accueillir ? Comment sont-ils ? Nous ne leurs voulons aucun mal. Je leur dirai, que je n’ai pas choisi de quitter la France, je n’ai pas choisi de venir chez eux, je voulais comme les autres une société plus juste, promesse de lendemains heureux, je voulais vivre libre de toute religion, de toute oppression. Soixante-treize jours seulement, c’est bien court pour refaire le monde, nous n’avons pas eu assez de temps, nous étions partis à l’assaut du ciel, les lilas de Belleville sentaient si bons, Eugène avait les yeux si bleus, nous n’irons plus les cueillir. Nous n’avons pas eu de chance, les autres étaient plus nombreux, il a fallu nous rendre. Ils ont fusillé des milliers d’insurgés, mais le sang de nos martyrs fera lever une moisson nouvelle. Qu’il vienne enfin ce pays nouveau et la fin de ce voyage, hélas, je suis toujours déportée, pestiférée. J’espère et je crains l’arrivée au port, enfin le calme mais surement aussi le bagne barbare.